Retour sur la vis attractiva concursus en droit de l’Union européenne
Une action introduite dans un État membre contre une société, tendant au paiement de marchandises livrées, bien qu’elle ne fasse état ni de la procédure d’insolvabilité antérieurement ouverte contre cette société dans un autre État membre ni du fait que la créance a déjà été déclarée dans la masse de l’insolvabilité, ne constitue pas une action dérivant directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement. Par conséquent, elle ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de la procédure d’insolvabilité.
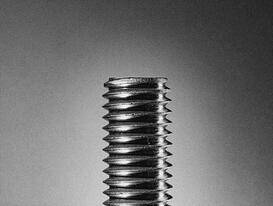
Le droit comparé de l’insolvabilité comprend un principe en vertu duquel le tribunal saisi d’une procédure collective connaît de tout ce qui la concerne. Désigné par l’expression vis attractiva concursus (force d’attraction de la faillite), ce principe traditionnel de prorogation matérielle de compétence se justifie par l’influence réciproque, plus souvent encore que la connexité ou l’indivisibilité, des questions qui peuvent se poser et la nécessité pratique d’en grouper le traitement judiciaire. En droit de l’Union européenne, l’application de la vis attractiva concursus est à l’origine d’une abondante jurisprudence dont le présent arrêt constitue un récent développement.
En l’espèce, une société belge avait livré du carburant pour le compte d’une société néerlandaise dans le cadre d’un ensemble de contrats d’avitaillement. La cliente ayant été soumise à une procédure d’insolvabilité principale ouverte aux Pays-Bas, le créancier avait produit sa créance résultant d’une facture impayée et, postérieurement, avait aussi assigné en paiement la débitrice devant une juridiction belge, car une condamnation de la débitrice s’avérait nécessaire pour qu’il puisse actionner les garanties bancaires constituées à son bénéfice.
En première instance, les juges belges s‘étaient déclarés compétents mais avaient jugé irrecevable la demande du créancier sur le fondement des dispositions du droit des entreprises en difficulté. À la suite de l’appel du créancier, la juridiction d’appel avait estimé devoir examiner de manière plus approfondie sa compétence internationale, après avoir constaté que le débiteur n’avait jamais comparu, ni en première instance ni devant elle. Cette compétence internationale étant fixée, alternativement, soit par les dispositions du règlement (UE) n° 1215/20212 (dit « Bruxelles I bis ») soit par celles du premier règlement Insolvabilité (Règl. [CE] n° 1346/2000), elle avait donc saisi la Cour de justice de deux questions préjudicielles afin de préciser l’articulation entre les champs d’application respectifs des deux instruments.
D’abord, il était demandé à la Cour de déterminer si l’action du créancier tombait sous le coup des dispositions de l’article 1er, § 2, b), du règlement Bruxelles I bis, lequel pour mémoire exclut du champ d’application de cet instrument les « les faillites, concordats et autres procédures analogues ».
Ensuite, il était demandé de vérifier la compatibilité avec le règlement Insolvabilité des dispositions de la loi néerlandaise – en tant que lex fori concursus – en ce qu’elles paraissaient autoriser qu’une action soit intentée contre le débiteur, mais avec des effets patrimoniaux, devant une autre juridiction que celle ayant ouvert la procédure d’insolvabilité. En effet, l’article 25, § 2, de la wet op het faillissement en de surséance van betaling (loi sur la faillite et le sursis de paiement), du 30 septembre 1893 (NFW) semblait admettre une telle option sur le fondement d’une distinction entre les actions concernant les intérêts personnels du failli par opposition à celles se rapportant à la masse de la procédure d’insolvabilité.
Dans une décision très motivée et synthétisant tous les progrès de sa jurisprudence en la matière, la Cour de justice décide que l’exclusion de l’article 1er, § 2, b), du règlement Bruxelles I bis ne s’applique pas à une action introduite dans un État membre contre une société, tendant au paiement de marchandises livrées, qui ne fait état ni de la procédure d’insolvabilité antérieurement ouverte contre cette société dans un autre État membre ni du fait que la créance a déjà été déclarée dans la masse de l’insolvabilité. Dans ces conditions, elle juge qu’il n’est pas nécessaire de répondre à la deuxième question préjudicielle.
Critères de l’action annexe ou connexe
Dans le système des règlements Bruxelles I bis et Insolvabilité, la compétence des juridictions de l’État d’ouverture est exclusive. Par conséquent, dès lors que le premier exclut de son champ d’application matérielle les procédures d’insolvabilité, tout ce qui ne relève pas à ce titre de cet instrument doit relever du règlement Insolvabilité et inversement. La Cour de justice entend ainsi éviter à la fois les vides et les chevauchements (v. ainsi, CJUE 6 févr. 2019, NK, aff. C-535/17, Dalloz actualité, 22 févr. 2019, obs. F. Mélin ; D. 2019. 262 ![]() ; ibid. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux
; ibid. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux ![]() ; 18 sept. 2019, Riel, aff. C-47/18, Dalloz actualité, 9 oct. 2019, obs. F. Mélin ; D. 2019. 2277
; 18 sept. 2019, Riel, aff. C-47/18, Dalloz actualité, 9 oct. 2019, obs. F. Mélin ; D. 2019. 2277 ![]() , note J.-L. Vallens
, note J.-L. Vallens ![]() ; ibid. 2020. 1970, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux
; ibid. 2020. 1970, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux ![]() ; Rev. crit. DIP 2020. 139, note L. Pailler
; Rev. crit. DIP 2020. 139, note L. Pailler ![]() ; JDI 2021. 697, note F. Jault-Seseke et D. Robine), intention louable alors que la pratique révèle toutes les difficultés de cette articulation comme en témoigne le constat dressé par le projet européen Enhancing Enforcement under Brussels Ia (En2BrIa ; sur ce projet, v. https://dispi.unige.it/node/1042 [consulté le 16 déc. 2024]).
; JDI 2021. 697, note F. Jault-Seseke et D. Robine), intention louable alors que la pratique révèle toutes les difficultés de cette articulation comme en témoigne le constat dressé par le projet européen Enhancing Enforcement under Brussels Ia (En2BrIa ; sur ce projet, v. https://dispi.unige.it/node/1042 [consulté le 16 déc. 2024]).
Le champ d’application du règlement insolvabilité doit être interprété strictement (CJUE 20 déc. 2017, Valach e.a., aff. C-649/16, D. 2018. 18 ![]() ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ![]() ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ![]() ; Europe 2018. 70, note L. Idot ; Procédures 2018. 14, note C. Nourissat) pour n’inclure que les actions dites « annexes » ou « connexes », c’est-à-dire qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui y sont étroitement liées, conformément à la célèbre jurisprudence Gourdain (CJCE 22 févr. 1979, aff. C-133/78, Rec. CJCE 1979. 733, concl. Reiscshl ; Rev. crit. DIP 1979. 657, note J. Lemontey ; Rev. sociétés 1980. 526, note J.-L. Bismuth). Toute la difficulté est alors de déterminer ce qu’est précisément une telle action annexe.
; Europe 2018. 70, note L. Idot ; Procédures 2018. 14, note C. Nourissat) pour n’inclure que les actions dites « annexes » ou « connexes », c’est-à-dire qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui y sont étroitement liées, conformément à la célèbre jurisprudence Gourdain (CJCE 22 févr. 1979, aff. C-133/78, Rec. CJCE 1979. 733, concl. Reiscshl ; Rev. crit. DIP 1979. 657, note J. Lemontey ; Rev. sociétés 1980. 526, note J.-L. Bismuth). Toute la difficulté est alors de déterminer ce qu’est précisément une telle action annexe.
D’abord, et pour mémoire, dans un arrêt German Graphics, la Cour de justice a estimé que ne dérivait pas de la procédure de faillite et ne s’y insérait pas étroitement « l’action autonome, ne trouvant pas son fondement dans le droit des procédures d’insolvabilité et ne requérant ni l’ouverture d’une procédure de ce type ni l’intervention d’un syndic » (CJCE 10 sept. 2009, aff. C-292/08, Dalloz actualité, 29 sept. 2009, obs. A. Lienhard ; D. 2009. 2782, et les obs. ![]() , note J.-L. Vallens
, note J.-L. Vallens ![]() ; ibid. 2010. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
; ibid. 2010. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ![]() ; ibid. 2323, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; ibid. 2323, obs. L. d’Avout et S. Bollée ![]() ; RTD com. 2010. 211, obs. J.-L. Vallens
; RTD com. 2010. 211, obs. J.-L. Vallens ![]() ; ibid. 212, obs. J.-L. Vallens
; ibid. 212, obs. J.-L. Vallens ![]() ; RTD eur. 2010. 421, chron. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard
; RTD eur. 2010. 421, chron. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard ![]() ; Europe 2009. 31, note L. Idot ; Procédures 2009. 20, note C. Nourissat ; RLDC 2009. 35, note J.-J. Ansault ; RPC 2009. Comm. 154, note T. Mastrullo).
; Europe 2009. 31, note L. Idot ; Procédures 2009. 20, note C. Nourissat ; RLDC 2009. 35, note J.-J. Ansault ; RPC 2009. Comm. 154, note T. Mastrullo).
Puis dans un arrêt Nickel & Goeldner Spedition (CJUE 4 sept. 2014, aff. C-157/13, pts 22 et 23, D. 2014. 1822 ![]() ; ibid. 2015. 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; ibid. 2015. 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée ![]() ; Rev. crit. DIP 2015. 207, note C. Legros
; Rev. crit. DIP 2015. 207, note C. Legros ![]() ; RTD com. 2015. 180, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast
; RTD com. 2015. 180, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ![]() ) la Cour a semblé retenir un critère : le fondement juridique de l’action. Ainsi, seules les actions se fondant sur les règles dérogatoires spécifiques du droit des entreprises en difficulté relevaient de la compétence du tribunal de la procédure d’insolvabilité. Mais les décisions postérieures ont pu faire douter de son applicabilité générale (CJUE 4 déc. 2014, H c/ H.K, aff. C-295/13, D. 2015. 71
) la Cour a semblé retenir un critère : le fondement juridique de l’action. Ainsi, seules les actions se fondant sur les règles dérogatoires spécifiques du droit des entreprises en difficulté relevaient de la compétence du tribunal de la procédure d’insolvabilité. Mais les décisions postérieures ont pu faire douter de son applicabilité générale (CJUE 4 déc. 2014, H c/ H.K, aff. C-295/13, D. 2015. 71 ![]() ; ibid. 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; ibid. 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée ![]() ; Rev. crit. DIP 2015. 462, note D. Bureau
; Rev. crit. DIP 2015. 462, note D. Bureau ![]() ; BJS févr. 2015, n° 113a8, p. 95, note D. Robine et F. Jault-Seseke ; RPC 2015. Comm. 141, note M. Menjucq).
; BJS févr. 2015, n° 113a8, p. 95, note D. Robine et F. Jault-Seseke ; RPC 2015. Comm. 141, note M. Menjucq).
La décision rapportée renoue avec l’orthodoxie antérieure. L’élément déterminant pour qualifier une action d’annexe est non le contexte procédural dans lequel s’inscrit l’action, mais le fondement juridique de cette dernière. Aussi, convient-il de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité. À cet égard, il faut plus particulièrement se demander si l’action se fonde sur le droit des entreprises en difficulté et requiert, pour être exercée, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et l’intervention d’un praticien de l’insolvabilité. Cependant, la simple intervention du praticien de l’insolvabilité ne saurait soustraire à la matière commerciale générale une action (v. ainsi, CJUE 19 avr. 2012, F-Tex, aff. C-213/10, D. 2012. 1185, et les obs. ![]() ; ibid. 2331, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; ibid. 2331, obs. L. d’Avout et S. Bollée ![]() ; BJE juill. 2012, n° JBE-2012-0127, p. 245, note L. C. Henry ; LEDEN juin 2012, n° 96, p. 7, note F. Mélin ; adde CJUE 21 nov. 2019, CeDe Group, aff. C-198/18, D. 2019. 2294
; BJE juill. 2012, n° JBE-2012-0127, p. 245, note L. C. Henry ; LEDEN juin 2012, n° 96, p. 7, note F. Mélin ; adde CJUE 21 nov. 2019, CeDe Group, aff. C-198/18, D. 2019. 2294 ![]() ; Rev. crit. DIP 2020. 545, note E. Farnoux
; Rev. crit. DIP 2020. 545, note E. Farnoux ![]() ; BJS mars 2020, n° 120p6, p. 42, note T. Mastrullo). Les prérogatives reconnues au praticien doivent en effet exercer une véritable influence sur la question juridique posée par l’action (CJUE 2 juill. 2009, SCT Industri, aff. C-111/08, D. 2009. 2384, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; BJS mars 2020, n° 120p6, p. 42, note T. Mastrullo). Les prérogatives reconnues au praticien doivent en effet exercer une véritable influence sur la question juridique posée par l’action (CJUE 2 juill. 2009, SCT Industri, aff. C-111/08, D. 2009. 2384, obs. L. d’Avout et S. Bollée ![]() ; RTD eur. 2010. 421, chron. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard
; RTD eur. 2010. 421, chron. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard ![]() ; Procédures 2009. 19, note C. Nourissat ; RPC 2009. 32, note T. Mastrullo).
; Procédures 2009. 19, note C. Nourissat ; RPC 2009. 32, note T. Mastrullo).
En l’espèce, l’action exercée trouvait son fondement dans le droit contractuel. De plus fort, l’action en paiement aurait pu être exercée en l’absence de procédure d’insolvabilité et l’ouverture de cette dernière procédure n’avait pas modifié le fondement juridique de l’action.
Ensuite, s’agissant de déterminer si l’action s’insère étroitement dans la procédure d’insolvabilité, l’appréciation de l’intensité du lien entre l’action en cause et la procédure d’insolvabilité suscite aussi des incertitudes. La Cour de justice a stabilisé sa jurisprudence dans les arrêts Tünkers (CJUE 9 nov. 2017, aff. C-641/16, D. 2017. 2357 ![]() , note J.-L. Vallens
, note J.-L. Vallens ![]() ; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ![]() ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ![]() ; BJS janv. 2018, n° 117e1, p. 51, note F. Jault-Seseke et D. Robine ; Europe 2018. 39, note L. Idot ; Procédures 2018. 23, note C. Nourissat) et Valach (CJUE 20 déc. 2017, aff. C-649/16, D. 2018. 18
; BJS janv. 2018, n° 117e1, p. 51, note F. Jault-Seseke et D. Robine ; Europe 2018. 39, note L. Idot ; Procédures 2018. 23, note C. Nourissat) et Valach (CJUE 20 déc. 2017, aff. C-649/16, D. 2018. 18 ![]() ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ![]() ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ![]() ; Europe 2018. 70, note L. Idot ; Procédures 2018. 14, note C. Nourissat). Pour déterminer si l’action s’insère étroitement il faut mesurer l’intensité du lien existant entre l’action juridictionnelle et la procédure d’insolvabilité. Or, le lien existant en l’espèce se limitait au fait que le créancier poursuivait le paiement d’une créance qu’il avait déclarée au passif de la procédure d’insolvabilité.
; Europe 2018. 70, note L. Idot ; Procédures 2018. 14, note C. Nourissat). Pour déterminer si l’action s’insère étroitement il faut mesurer l’intensité du lien existant entre l’action juridictionnelle et la procédure d’insolvabilité. Or, le lien existant en l’espèce se limitait au fait que le créancier poursuivait le paiement d’une créance qu’il avait déclarée au passif de la procédure d’insolvabilité.
Par conséquent, l’action du créancier ne satisfait ni au premier ni au second critère et ne constitue pas une action annexe. Dès lors, elle relève du champ d’application du seul règlement Bruxelles I bis.
Mise en échec justifiée de la vis attractiva concursus
La mise en échec de la vis attractiva concursus en l’espèce pourrait sembler choquante. En effet pour échapper à la vis attractiva concursus, le créancier avait intenté son action sans mentionner l’existence de la procédure d’insolvabilité, procédure dont il ne pouvait ignorer l’existence puisqu’il avait déclaré sa créance. De plus fort, l’objet même de cette action était le recouvrement de la créance déclarée. Cela explique sans doute que la Cour ait jugé nécessaire de motiver sa décision en faisant preuve d’une pédagogie remarquable.
La Cour de justice souligne que l’application de principe de la lex fori concursus (Règl. [CE] n° 1346/2000, art. 4) conduit à ce que le tribunal de la procédure d’insolvabilité applique la plupart du temps sa propre loi et que, réciproquement, cette même loi soit appliquée par le tribunal de la procédure à l’essentiel des questions intéressant le traitement des difficultés du débiteur. Mais cette solution résulte d’une règle de conflit – édictée à l’article 4 dans le premier règlement et à l’article 7 dans le règlement révisé (Règl. [UE] 2015/848) – qui a vocation à être appliquée même par des juridictions qui ne sont pas celles ayant ouvert la procédure d’insolvabilité.
Ainsi, en l’espèce, si l’action du créancier peut effectivement être exercée devant le juge belge, ce juge doit appliquer le droit néerlandais en tant que lex fori concursus, cette loi régissant notamment les effets de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours et les incidences de cette procédure sur les poursuites individuelles (Règl. [CE] n° 1346/2000, art. 4, § 2, e) et f) ; Règl. [UE] 2015/848, art. 7, § 2, e) et f)). L’application de la lex fori concursus par une juridiction autre que celle ayant ouvert la procédure d’insolvabilité permet de veiller au respect de la discipline collective et à la réalisation des objectifs du droit des entreprises en difficulté.
La solution peut aussi se recommander des dispositions pertinentes du règlement Insolvabilité révisé. En effet, à la différence du règlement (CE) n° 1346/2000, le règlement (UE) 2015/848 comporte une disposition visant expressément les actions dites « annexes » ou « connexes » (Règl. [UE] n° 2015/848, art. 6, § 1 ; sur cette disposition, F. Garcimartín, Cross-border vis attractiva concursus : the EU approach, Insolv. Int. 2018, p. 14 s.). Ainsi son article 6, § 1, prévoit que les tribunaux de l’État d’ouverture ont compétence « pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d’insolvabilité et qui y est étroitement liée, telles les actions révocatoires ». Mais les dispositions de son article 6, § 2, introduisent une option inédite permettant au praticien de l’insolvabilité de saisir le for du défendeur dès lors que diverses conditions – rigoureuses – sont réunies : l’action exercée par le praticien de l’insolvabilité doit être connexe à la procédure d’insolvabilité ainsi qu’à une action en matière civile et commerciale aux sens du règlement de Bruxelles I bis intentée contre le même défendeur.
Une telle neutralisation de la vis attractiva concursus révèle que le législateur européen a souhaité promouvoir une appréciation large du champ d’application du règlement Bruxelles I bis pour déterminer le juge compétent en matière d’actions annexes (K. Crison et L. Fitzgerald, When will actions be considered sufficiently closely connected to fall within the scope of the Insolvency Regulation in light of Tünkers Maschinebau GmbH vs Expert France ?, C.R. & I 2018, vol. 11, n° 1, p. 14).
Dès lors, un constat s’impose : les règles de compétence judiciaire et de compétence législative ont une sphère d’application autonome dans les règlements Insolvabilité. Plus encore que par une unité de juridiction, la poursuite des objectifs fixés par ces instruments est avant tout organisée par l’application d’une seule loi – la lex fori concursus – à l’essentiel des questions intéressant le traitement des difficultés du débiteur.
© Lefebvre Dalloz