Revirement sur la péremption d’instance : un beau moment de justice
Une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d’accomplir une diligence particulière. Lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d’interrompre le cours de la prescription.
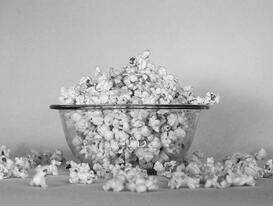
En fait de péremption d’instance et de son rapport à la clôture et fixation, la Cour de cassation se trouvait à la croisée des chemins : persévérer dans son ancienne jurisprudence aux accents formalistes ou revirer. Par une série de quatre arrêts accueillie par des hourras numériques, la deuxième chambre civile fait le choix du revirement. Ces quatre arrêts commentés de concert offrent un beau moment de justice sur la forme comme sur le fond.
Sur la forme, la deuxième chambre civile offre assurément un beau moment de justice. Outre que ces quatre arrêts, prononcés en rafale selon une technique éprouvée au quai de l’Horloge, sont rendus en section et promis à une publication au Bulletin (le défaut de commentaire au Rapport pouvant étonner), de nombreux marqueurs permettent d’en détecter la grande valeur formelle. La motivation est enrichie et non seulement développée : explicitation des textes, exposé de la jurisprudence ancienne avec chaînage, énonciations des raisons du revirement lui-même identifié comme tel, audition publique d’amici curiae en les personnes du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris et du président du Conseil national des barreaux, lesquels – en plus du président de la conférence des premiers présidents de cour d’appel – ont chacun déposé une note écrite à la façon d’une « porte étroite ».
La Cour expose même dans sa motivation certains enseignements retirés de l’audition de ses amis selon un procédé inédit à notre connaissance. Le haut patronage de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme est encore convoqué. Chose remarquable, la Cour de cassation prend soin d’indiquer les modalités d’application dans le temps de son revirement, en conscience de ses implications systémiques. Cette série d’arrêts ravira les amateurs de belle décision, même si leur motivation, un peu bavarde et tortueuse, n’en simplifie pas l’analyse.
Cette jurisprudence nouvelle rappellera à de nombreux égards l’avis du 8 juillet 2022 sur l’annexe à la déclaration d’appel qui avait lui aussi offert un beau moment de justice (Civ. 2e, avis, 8 juill. 2022, n° 22-70.005, Dalloz actualité, 30 août 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 1498 ![]() , note M. Barba
, note M. Barba ![]() ; AJ fam. 2022. 496, obs. D. D’Ambra
; AJ fam. 2022. 496, obs. D. D’Ambra ![]() ; l’annexe est d’ailleurs à l’honneur dans d’autres arrêts du même jour, Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 22-20.035 et n° 22-23.522, D. 2024. 551
; l’annexe est d’ailleurs à l’honneur dans d’autres arrêts du même jour, Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 22-20.035 et n° 22-23.522, D. 2024. 551 ![]() ).
).
Sur le fond aussi, la deuxième chambre civile offre un beau moment de justice. Car la décision semble effectivement juste cependant que la jurisprudence qu’elle revire paraissait invariablement injuste. Et on ne parle pas là que de justesse technique mais de justice substantielle, d’équité croyons-nous. En cause d’appel, en application de la jurisprudence antérieure, les parties assumaient la charge – et le risque associé – de l’allongement des délais de clôture et fixation. Désormais, avec la jurisprudence nouvelle, la longueur des délais de clôture et fixation est assumée avant tout par la machine juridictionnelle. Le problème de fond reste intact – la durée des procédures d’appel, dont le rétrécissement ne procèdera pas de la récente réforme opérée par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 (M. Barba et R. Laffly, « Simplification » de la procédure d’appel en matière civile, Dalloz actualité, 1er févr. 2024 ; K. Leclere Vue et L. Veyre, Réforme de la procédure d’appel en matière civile : explication de texte, D. 2024. 362 ![]() ; J. Jourdan-Marques, Chronique d’arbitrage : l’influence du décret du 29 décembre 2023 sur l’exercice des voies de recours, Dalloz actualité, 12 janv. 2024 ; N. Gerbay, Le décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile : nouveautés et points de vigilance, Procédures 2024. Étude 1). En revanche, les parties ne l’assument plus au premier chef. En cela au moins, cette volée d’arrêts est digne d’approbation, sans compter que chacun affiche les difficultés structurelles en cause d’appel en termes de délais, ce qui doit interpeller au plus haut niveau de l’État.
; J. Jourdan-Marques, Chronique d’arbitrage : l’influence du décret du 29 décembre 2023 sur l’exercice des voies de recours, Dalloz actualité, 12 janv. 2024 ; N. Gerbay, Le décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile : nouveautés et points de vigilance, Procédures 2024. Étude 1). En revanche, les parties ne l’assument plus au premier chef. En cela au moins, cette volée d’arrêts est digne d’approbation, sans compter que chacun affiche les difficultés structurelles en cause d’appel en termes de délais, ce qui doit interpeller au plus haut niveau de l’État.
Venons-en – enfin ! – au revirement lui-même et à la jurisprudence nouvellement inaugurée.
Selon la jurisprudence antérieure valant en procédure d’appel avec représentation obligatoire suivant le circuit ordinaire avec mise en état, il appartient aux parties, après avoir conclu dans les délais Magendie, de faire toute diligence utile pour faire avancer l’instance jusqu’à son terme (Civ. 2e, 16 déc. 2016, n° 15-27.917, Dalloz actualité, 5 janv. 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 141 ![]() , note C. Bléry
, note C. Bléry ![]() ; ibid. 422, obs. N. Fricero
; ibid. 422, obs. N. Fricero ![]() ; ibid. 605, chron. E. de Leiris, N. Palle, G. Hénon, N. Touati et O. Becuwe
; ibid. 605, chron. E. de Leiris, N. Palle, G. Hénon, N. Touati et O. Becuwe ![]() ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero
; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ![]() ). En particulier, il leur revient, si elles s’estiment en état après l’échange des premières conclusions, de solliciter du conseiller de la mise en état (CME) la clôture de celle-ci et la fixation de l’affaire pour plaidoiries, i.e. la « clôture et fixation ». À défaut, la péremption court à compter de la dernière diligence interruptive, à l’instar des conclusions d’intimés. Lorsque les parties sollicitent du CME qu’il clôture et fixe, leur demande interrompt mais ne suspend pas le délai de péremption : un nouveau délai commence à courir (Civ. 2e, 1er févr. 2018, n° 16-17.618, Dalloz actualité, 23 févr. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2019. 555, obs. N. Fricero
). En particulier, il leur revient, si elles s’estiment en état après l’échange des premières conclusions, de solliciter du conseiller de la mise en état (CME) la clôture de celle-ci et la fixation de l’affaire pour plaidoiries, i.e. la « clôture et fixation ». À défaut, la péremption court à compter de la dernière diligence interruptive, à l’instar des conclusions d’intimés. Lorsque les parties sollicitent du CME qu’il clôture et fixe, leur demande interrompt mais ne suspend pas le délai de péremption : un nouveau délai commence à courir (Civ. 2e, 1er févr. 2018, n° 16-17.618, Dalloz actualité, 23 févr. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2019. 555, obs. N. Fricero ![]() ; AJ fam. 2018. 262, obs. M. Jean
; AJ fam. 2018. 262, obs. M. Jean ![]() ; Gaz. Pal. 15 mai 2018, n° 17, p. 71, note L. Raschel). Dès lors que le CME clôture et fixe, la difficulté s’efface puisque, de jurisprudence constante et ancienne, la direction de la procédure échappe alors aux parties : la péremption ne court plus (v. not., Civ. 2e, 12 févr. 2004, n° 01-17.565, RTD civ. 2004. 347, obs. R. Perrot
; Gaz. Pal. 15 mai 2018, n° 17, p. 71, note L. Raschel). Dès lors que le CME clôture et fixe, la difficulté s’efface puisque, de jurisprudence constante et ancienne, la direction de la procédure échappe alors aux parties : la péremption ne court plus (v. not., Civ. 2e, 12 févr. 2004, n° 01-17.565, RTD civ. 2004. 347, obs. R. Perrot ![]() ; 16 déc. 2016, n° 15-26.083, Dalloz actualité 10 janv. 2017, obs. F. Mélin ; D. 2017. 141
; 16 déc. 2016, n° 15-26.083, Dalloz actualité 10 janv. 2017, obs. F. Mélin ; D. 2017. 141 ![]() , note C. Bléry
, note C. Bléry ![]() ; ibid. 422, obs. N. Fricero
; ibid. 422, obs. N. Fricero ![]() ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero
; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ![]() ; JCP 2017. 106, note D. Cholet). En revanche, lorsque le CME ne clôture ni ne fixe, un faux temps mort s’installe où l’affaire est « à fixer » : le couperet de la péremption s’abat alors doucement mais sûrement (Civ. 2e, 16 déc. 2016, n° 15-27.917, préc.).
; JCP 2017. 106, note D. Cholet). En revanche, lorsque le CME ne clôture ni ne fixe, un faux temps mort s’installe où l’affaire est « à fixer » : le couperet de la péremption s’abat alors doucement mais sûrement (Civ. 2e, 16 déc. 2016, n° 15-27.917, préc.).
Du temps de cette jurisprudence, les avocats rivalisaient d’inventivité pour tenter d’interrompre la péremption. Les praticiens communiquaient à qui mieux mieux sur leurs pratiques respectives, globalement inefficaces car une diligence inutile n’interrompt ni ne suspend le délai de péremption, en particulier lorsqu’elle est la réplique d’une diligence antérieure et qu’elle a donc pour seul but d’interrompre le délai de péremption (Civ. 3e, 28 févr. 1990, n° 88-11.574 ; v. néanmoins, Civ. 2e, 11 févr. 2018, n° 16-17.618, qui paraît avaliser la pratique d’une nouvelle demande de fixation). Au vrai, rien ne semblait pouvoir arrêter la chute du couperet de la péremption, sauf l’intervention salvatrice de l’ordonnance de clôture et fixation tant espérée.
Quatre affaires se présentent à la Cour de cassation de configuration similaire. Appel d’un jugement est relevé, qui suit le circuit ordinaire avec mise en état. Chaque partie conclut dans son délai initial. Aucune ne sollicite la clôture et fixation du CME, lequel ne clôture ni ne fixe de son propre chef. Le couperet de la péremption s’abat dans trois affaires sur quatre, une cour d’appel – et même plutôt une formation particulière de celle-ci – faisant de la résistance dans la quatrième (pourvoi n° 21-20.719).
Quatre affaires différentes pour une série de problématiques identiques : la péremption court-elle à l’encontre de parties ayant conclu dans leur délai Magendie qui sont dans l’attente d’une clôture et fixation ? Dans l’affirmative, leur incombe-t-il de saisir le CME d’une demande de clôture et fixation afin d’interrompre le cours de la péremption ? Dans l’affirmative, cette demande de clôture et fixation suspend-elle, en plus d’interrompre, le délai de péremption ?
La deuxième chambre civile répond à la première de ces interrogations, opérant revirement :
« Lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. » (§ 14 de l’arrêt rendu sur le pourvoi n° 21-19.475, pris pour référence par la suite) ;
« …une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière » (§ 17).
À la deuxième interrogation la deuxième chambre civile répond que :
« Lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption. » (§ 16).
Quant à la troisième interrogation, qui concerne l’effet suspensif et non uniquement interruptif de la demande de clôture et fixation, elle ne reçoit logiquement aucune réponse compte tenu des précédentes, sauf à l’induire des paragraphes précités. Nous y reviendrons.
Revirement est en tout cas opéré et il est, précise la Cour, « immédiatement applicable en ce qu’il assouplit les conditions de l’accès au juge » (§ 19). Sous l’angle du droit transitoire, cette décision est orthodoxe, même si certains considéreront que la partie adverse ayant éventuellement « bénéficié » de la péremption paie cette rétroactivité in mitius sur ses propres droits à la sécurité juridique.
Dans trois affaires, est prononcée l’annulation de l’arrêt déféré conformément à la pratique de la Cour en cas de revirement. Le dernier pourvoi est rejeté, consacrant la résistance efficace du fond.
Cette volée d’arrêts a un apport certain en appel ; d’autres prolongements possibles en première instance s’agitent dans son ombre.
Apport certain en appel
Voyons les motifs du revirement, avant le détail de la solution nouvelle.
Motifs
Avant les motifs eux-mêmes, il faut consulter le visa :
« Vu l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ».
Le visa de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne n’est pas sans intérêt mais le droit au procès équitable joue là le rôle d’aiguilleur : il ne dicte pas la solution mais donne une direction générale dans sa recherche. Le visa des articles 2, 386, 908 et 909 n’est pas non plus d’un grand intérêt immédiat en tant qu’il s’agit pour l’essentiel des textes pertinents, même si le premier d’entre eux figure au titre des principes directeurs, ce qui donne une certaine majesté à la solution, voire autorise une certaine généralisation (v. infra).
Le visa de l’article 912, dont le contenu n’a pas vraiment changé avec le décret de 2017, est en revanche d’un plus grand intérêt. C’est en effet lui qui fixe l’office du CME en ses deux premiers alinéas, aux termes desquels il « examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats ». C’est cette disposition qui invite au revirement, du moins telle que combinée à l’article 910-4 également visé, qui s’avère décisif dans la motivation.
De fait, dans ces quatre arrêts, la Cour de cassation ne fait pas, comme on le voit parfois, la critique ou l’éloge de sa jurisprudence antérieure. Elle n’en souligne ni le mérite ni les défauts ; elle n’en dit rien, sauf son contenu (§ 11). Dès lors, ce n’est pas une faiblesse propre de la jurisprudence antérieure qui conduit au revirement mais plutôt, à lire la Cour, une évolution postérieure du droit écrit. Et c’est effectivement ce que la deuxième chambre civile souligne : « le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond » (§ 13).
La Cour ajoute que la demande de fixation de l’affaire formulée par les parties « se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d’appel saisie se trouve dans l’impossibilité, en raison de rôles d’audience d’ores et déjà complets, de fixer l’affaire dans un délai inférieur à deux ans » (§ 15).
En somme, le revirement est conduit sur trois motifs. Premièrement, aux termes de l’article 912, il incombe au CME de fixer et clôturer lorsque les parties ont conclu dans leur délai. Deuxièmement et de plus fort, il en va de son office en tant que les parties sont réputées avoir concentré leurs prétentions dans leurs premières conclusions. Troisièmement et de plus fort encore, une demande de clôture et fixation se révèle souvent vaine. La solution nouvelle en découle.
Solution
L’apport indiscutable de cette série d’arrêts est qu’en appel avec représentation obligatoire en circuit long, lorsque les parties ont chacune conclu dans leur délai Magendie, la péremption ne court plus à leur encontre. De plus, mais c’est lié, il n’incombe plus aux parties dans cette même configuration de demander au CME de clôturer et fixer.
La Cour réserve deux hypothèses : d’une part, le cas où le CME fixe un calendrier de procédure, comme l’autorise l’article 912 du code de procédure civile ; d’autre part, le cas où le CME enjoint aux parties de réaliser des diligences particulières, comme l’y autorise généralement l’article 3 du même code. De là, plusieurs interrogations surgissent.
Tout d’abord, qu’advient-il de l’hypothèse dans laquelle le CME clôture et fixe ? La jurisprudence antérieure est maintenue à tous égards : la direction de la procédure échappe alors aux parties de sorte que la péremption ne menace plus (v. not., Civ. 2e, 12 févr. 2004, n° 01-17.565, préc.).
Ensuite, qu’advient-il de l’hypothèse où les parties sollicitent malgré tout du CME une clôture et fixation ? Les habitudes ont la vie dure et il n’est pas à exclure que les parties demandent au CME la clôture et fixation ensuite de la remise de leurs conclusions dans les délais Magendie. Cette hypothèse est simple à traiter : il est constant que la péremption ne court plus contre les parties dans l’attente d’une initiative du CME. Dès lors, l’inutile demande de clôture et fixation n’est pas de nature à réenclencher le mécanisme de la péremption.
Encore, qu’advient-il dans l’hypothèse différente où les parties entreprennent de conclure à nouveau de leur propre initiative après l’expiration des délais Magendie ? Dès lors que le CME n’a ni clôturé ni fixé un calendrier, les parties peuvent conclure, en invoquant de nouveaux moyens jusqu’à la clôture (Civ. 2e, 20 oct. 2022, n° 21-17.375, Dalloz actualité, 14 nov. 2022, obs. C. Lhermitte ; 4 juin 2015, n° 14-10.548, Dalloz actualité, 18 juin 2015, obs. M. Kebir ; D. 2015. 1279 ![]() ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle
; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle ![]() ). Cette hypothèse est plus délicate car, en ce cas, les parties témoignent de ce qu’elles ont encore des moyens à ajouter au soutien de leurs prétentions, voire des prétentions à ajouter, qui peuvent être recevables sur le fondement de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile. À tous égards, les parties paraissent avoir repris la direction de la procédure, de sorte que la péremption semble repartir à la première diligence utile, en l’occurrence lors du dépôt de nouvelles conclusions (§ 14 a contrario). C’est cependant douteux car il incombe invariablement au CME d’exercer son office dans les termes de l’article 912 du code de procédure civile. Les parties prennent certes des initiatives en la forme de conclusions et font diligence utile par rapport au fond ; mais, à proprement parler, le sort de la procédure est entre les mains du CME. Celui-ci peut clôturer et fixer ou, constatant que les parties ne se sont effectivement pas tout dit, arrêter un calendrier. La péremption ne menace pas dans l’attente de sa décision, pensons-nous.
). Cette hypothèse est plus délicate car, en ce cas, les parties témoignent de ce qu’elles ont encore des moyens à ajouter au soutien de leurs prétentions, voire des prétentions à ajouter, qui peuvent être recevables sur le fondement de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile. À tous égards, les parties paraissent avoir repris la direction de la procédure, de sorte que la péremption semble repartir à la première diligence utile, en l’occurrence lors du dépôt de nouvelles conclusions (§ 14 a contrario). C’est cependant douteux car il incombe invariablement au CME d’exercer son office dans les termes de l’article 912 du code de procédure civile. Les parties prennent certes des initiatives en la forme de conclusions et font diligence utile par rapport au fond ; mais, à proprement parler, le sort de la procédure est entre les mains du CME. Celui-ci peut clôturer et fixer ou, constatant que les parties ne se sont effectivement pas tout dit, arrêter un calendrier. La péremption ne menace pas dans l’attente de sa décision, pensons-nous.
Qu’advient-il, précisément, dans l’hypothèse où le CME fixe un calendrier ou enjoint aux parties d’accomplir des diligences particulières ? Déjà, les réponses sont moins assurées, ce d’autant que la pratique du « calendrier 912 » n’est pas répandue à notre connaissance. En ce cas, il est constant que les parties doivent entreprendre des diligences utiles, en sorte que la direction de la procédure leur revient le temps du calendrier ou dans l’attente de la réalisation des diligences : la péremption court à compter de la décision du CME. Mais qu’advient-il au terme du calendrier ou postérieurement à la réalisation desdites diligences ? Dans ce cas, les parties soit demeureront taiseuses soit adresseront au CME une demande de clôture et fixation, notamment pour lui signifier qu’elles se sont tout dit ou ont réalisé les diligences imposées. D’une certaine façon, on revient à la configuration initiale et aux problématiques posées : la péremption court-elle contre les parties arrivées en bout de calendrier ? Dans l’affirmative, faut-il leur imposer de solliciter une clôture et fixation ? Dans l’affirmative, cette demande est-elle suspensive en plus d’être interruptive ?
Par cette série d’arrêts, la deuxième chambre civile ne répond pas à ces interrogations. De fait, ce n’était pas la configuration des arrêts déférés. Elle paraît plutôt concentrer sa jurisprudence nouvelle sur la seule hypothèse où les parties émergent des délais Magendie après avoir conclu. C’est d’autant plus vrai que l’article 912 du code de procédure civile ne fixe pas l’office obligatoire du CME à l’issue du calendrier qu’il a imposé aux parties. Dès lors, il est tentant de retenir que la péremption court alors à l’encontre des parties, qu’il leur incombe de demander la clôture et fixation, laquelle interrompt mais ne suspend pas, conformément à la jurisprudence classique. C’est une lecture disons pessimiste de cette série d’arrêts.
Cela étant, une autre lecture est possible, plus optimiste. De fait, si on isole le § 17 de l’arrêt de référence, la réponse est simple : « …une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre… ». Dès lors, à moins que le CME proroge les délais fixés dans le calendrier, comme le permet l’article 781 du code de procédure civile sur renvoi de l’article 907 du même code, on peut considérer que les parties parvenues au terme du calendrier ont accompli toutes leurs charges procédurales. Ce d’autant que, comme l’indique ce même article 781, les délais du calendrier ne sont prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée. Dès lors, la configuration semble similaire à celle où les parties ont chacune conclu dans leurs délais Magendie et attendent, pour ainsi dire, la décision du CME quant au sort de la procédure.
En sorte que les mêmes principes de solution seraient applicables : la direction de la procédure repasserait au CME au terme du calendrier déterminé par ses soins et il lui appartiendrait, à nouveau, soit de clôture et fixer, soit de proroger les délais, soit de prévoir un nouveau calendrier, soit d’enjoindre aux parties la réalisation de diligences particulières. En somme, la péremption ne courrait plus à l’encontre des parties et il ne saurait leur être imposé de solliciter la clôture et fixation. Cette autre interprétation des arrêts présenterait de surcroît l’avantage de décourager les CME qui envisageraient d’imposer systématiquement aux parties un calendrier de procédure, même fictivement, à seule fin de rendre aux parties la direction de la procédure et avec elle le risque de la péremption, pour les obliger in fine à formuler une demande de clôture et fixation.
Dans le doute, on recommandera aux praticiens de solliciter la clôture et fixation dans cette hypothèse ; mais il n’est pas exclu que la Cour de cassation étende son revirement à ce cas et neutralise aussi le cours de la péremption pour les parties arrivées en bout de « calendrier 912 ».
Il appartiendra également à la Cour de cassation de statuer sur les prolongements possibles en première instance.
Prolongements possibles en première instance
La question est de savoir si la jurisprudence nouvelle est transposable en première instance, en particulier en procédure avec représentation obligatoire et mise en état devant le tribunal judiciaire. La transposition est difficile mais pas impossible.
Une transposition difficile
La transposition en première instance de la jurisprudence nouvelle est difficile pour plusieurs raisons convergentes.
La deuxième chambre civile a soigneusement choisi son visa et ses motifs : outre les articles 6, § 1, de la Convention européenne, 2 et 386 du code de procédure civile, la jurisprudence nouvelle est adossée aux articles 908, 909, 910-4 et 912 du même code. Bien plus, elle est principalement adossée à la combinaison de ces quatre derniers : c’est parce que les parties doivent conclure dans des délais couperet (C. pr. civ., art. 908 et 909) en concentrant leurs prétentions (C. pr. civ., art. 910-4) que la direction de la procédure repasse au CME à l’expiration desdits délais, lequel doit exercer son office de clôture et fixation ou de détermination d’un calendrier de procédure (C. pr. civ., art. 912).
C’est encore parce que la demande de clôture et fixation se révèle vaine en appel qu’il n’y a pas lieu de l’imposer aux parties (§ 15). Ce sont les ingrédients de base de la jurisprudence nouvelle. Or ces ingrédients ne se retrouvent pas en première instance : aucune logique Magendie n’y est à l’œuvre ; il n’existe pas davantage de principe de concentration des prétentions au premier jeu de conclusions ; l’article 912 n’y connaît aucun équivalent.
En somme, c’est la rigidité même de la procédure d’appel qui conduit à la souplesse de la jurisprudence nouvelle en fait de péremption ; or cette rigidité ne se retrouve pas en première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à la même souplesse. Et à cet égard, on peine à imaginer une avocature qui réclamerait la rigidification de la première instance… à seule fin de pouvoir bénéficier des largesses en matière de péremption !
Ainsi, la transposition pure et simple de la jurisprudence nouvelle en première instance paraît difficile. Est-elle pour autant impossible ?
Une transposition possible
Pour les raisons précédemment énoncées, il est exclu d’imaginer l’arrêt du cours de la péremption ensuite de l’échange des premières conclusions devant le tribunal judiciaire. Cela n’aurait aucun sens. En revanche, ressurgit la question de l’effet de la demande de clôture et fixation, en particulier lorsqu’elle émane de toutes les parties en cause.
De jurisprudence constante, cette demande est interruptive mais non suspensive. C’est là que la série des quatre arrêts commentée peut influer. Formellement, il est vrai que ces arrêts ne portent pas revirement sur ce point : ils n’affirment aucunement que la demande de clôture et fixation est désormais suspensive en plus (ou en lieu et place) d’être interruptive. De fait, la deuxième chambre civile juge plus radicalement que les parties n’ont pas à formuler une telle demande à l’expiration des délais Magendie ; dès lors, elle ne dit rien de son effet sur la péremption.
Cela étant, on peut une nouvelle fois isoler plusieurs morceaux des arrêts, qui invitent à penser que la demande de clôture et fixation non contestée est désormais suspensive en plus d’être interruptive (cependant que les demandes de clôture et fixation contestées seraient simplement interruptives).
En effet, même si cette série d’arrêts est principalement soutenue par des dispositions propres à l’appel, il reste qu’elle est également soutenue par des dispositions générales, au premier rang desquelles l’article 2 du code de procédure civile, lequel invite à une forme de généralisation. Lorsque les parties se sont tout dit et sollicitent de concert (ou unilatéralement sans contestation), la clôture et fixation, ne peut-on pas retenir qu’elles ont terminé d’accomplir leurs incombances procédurales ? Or, suivant les arrêts examinés, « … une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre … » (§ 17). En sorte qu’à compter d’une demande de clôture et fixation émanant de toutes les parties ou d’une demande unilatérale recevant assentiment, on pourrait considérer que la péremption ne court plus.
Cette interprétation n’est pas assurée car le procédé consistant à isoler des morceaux choisis des arrêts n’est pas intellectuellement satisfaisant. Dès lors, on peut simplement espérer que le présent revirement en suscitera d’autres, au bénéfice des parties et de leurs avocats en première instance.
Le récent décret « appel » applicable au 1er septembre 2024 n’est pas de nature à fragiliser la jurisprudence nouvelle, l’article 912 n’évoluant pas en substance. En revanche, il est possible qu’elle soit brisée ou, du moins, reconfigurée à court terme par le pouvoir réglementaire au moyen du décret dit « Magicobus ». Dans le projet qui circule, il est prévu de pourvoir généralement la demande de clôture et fixation d’un effet suspensif du cours de la péremption, effet qui sera sans doute révoqué si une partie s’oppose à la clôture et fixation et qui sera sûrement révoqué au cas d’un refus du CME/JME. Alors, la jurisprudence nouvelle de la deuxième chambre civile se trouverait vraisemblablement brisée puisqu’il appartiendrait invariablement aux parties de solliciter la clôture et fixation, laquelle suspendra en revanche le cours de la péremption à coup sûr. L’innovation projetée serait donc à la fois moins protectrice des parties en appel mais plus protectrice en première instance ; elle constitue possiblement une solution médiane acceptable. Il est sinon loisible au pouvoir réglementaire de consacrer la présente jurisprudence de la Cour de cassation tout en affirmant généralement l’effet suspensif de la demande de clôture et fixation au regard du cours de la péremption. Il n’y aurait finalement là aucune contradiction. Ce serait même offrir aux justiciables un autre beau moment de justice.
Civ. 2e, 7 mars 2024, FS-B, n° 21-19.475
Civ. 2e, 7 mars 2024, FS-B, n° 21-19.761
Civ. 2e, 7 mars 2024, FS-B, n° 21-20.719
Civ. 2e, 7 mars 2024, FS-B, n° 21-23.230
© Lefebvre Dalloz