Sous-cautionnement, plan de sauvegarde et disproportion de l’engagement
Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2025, la chambre commerciale précise, d’une part, que la sous-caution ne peut pas opposer le plan de sauvegarde du débiteur principal et, d’autre part, que l’appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n’est plus respecté.
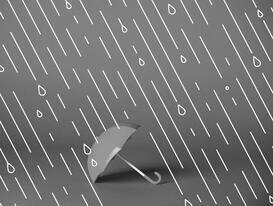
Le sous-cautionnement a été particulièrement à l’honneur ces derniers mois au sein de la jurisprudence de la Cour de cassation. La chambre commerciale a récemment refusé, pour les sous-cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022, de reconnaître un devoir de mise en garde dû par la caution professionnelle à l’égard de sa sous-caution (Com. 2 avr. 2025, n° 23-22.311 F-B, Dalloz actualité, 8 avr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1043 ![]() , note S. Cacioppo
, note S. Cacioppo ![]() ; RCJPP 2025, n° 03, p. 52, obs. C. Pastor
; RCJPP 2025, n° 03, p. 52, obs. C. Pastor ![]() ; RTD civ. 2025. 375, obs. C. Gijsbers
; RTD civ. 2025. 375, obs. C. Gijsbers ![]() ). Quelques jours plus tôt, la deuxième chambre civile était déjà revenue sur la force exécutoire attachée à l’engagement de sous-cautionnement au bénéfice de la caution quand celui-ci se trouve au sein d’un acte de prêt (Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-11.482 F-B, Dalloz actualité, 1er avr. 2025, obs. C. Hélaine ; RCJPP 2025, n° 03, p. 50, obs. J.-D. Pellier
). Quelques jours plus tôt, la deuxième chambre civile était déjà revenue sur la force exécutoire attachée à l’engagement de sous-cautionnement au bénéfice de la caution quand celui-ci se trouve au sein d’un acte de prêt (Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-11.482 F-B, Dalloz actualité, 1er avr. 2025, obs. C. Hélaine ; RCJPP 2025, n° 03, p. 50, obs. J.-D. Pellier ![]() ; ibid., n° 03, p. 75, chron. S. Piédelièvre et O. Salati
; ibid., n° 03, p. 75, chron. S. Piédelièvre et O. Salati ![]() ). À l’automne dernier, nous avions pu en outre croiser dans ces colonnes une décision ayant jugé que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal effectuée par la caution ayant réglé le créancier interrompt la prescription de son action contre la sous-caution jusqu’à la clôture de la procédure collective (Com. 9 oct. 2024, n° 22-18.093 FS-B, Dalloz actualité, 21 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 2149
). À l’automne dernier, nous avions pu en outre croiser dans ces colonnes une décision ayant jugé que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal effectuée par la caution ayant réglé le créancier interrompt la prescription de son action contre la sous-caution jusqu’à la clôture de la procédure collective (Com. 9 oct. 2024, n° 22-18.093 FS-B, Dalloz actualité, 21 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 2149 ![]() , note D. Sindrès
, note D. Sindrès ![]() ; RCJPP 2024, n° 06, p. 47, chron. P. Roussel Galle et F. Reille
; RCJPP 2024, n° 06, p. 47, chron. P. Roussel Galle et F. Reille ![]() ; ibid. 2025, n° 01, p. 36, obs. N. Hoffschir
; ibid. 2025, n° 01, p. 36, obs. N. Hoffschir ![]() ; RTD civ. 2024. 934, obs. C. Gijsbers
; RTD civ. 2024. 934, obs. C. Gijsbers ![]() ). Ce florilège atteste de l’intérêt pratique de la notion et de son traitement jurisprudentiel de plus en plus fréquent.
). Ce florilège atteste de l’intérêt pratique de la notion et de son traitement jurisprudentiel de plus en plus fréquent.
L’arrêt rendu le 9 juillet 2025 continue cette tendance en croisant la route, de nouveau, du droit des entreprises en difficulté. La décision intéressera grandement la pratique, certaines précisions pouvant être parfaitement transposées à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés.
Les faits ayant donné lieu au pourvoi puisent leur source dans l’acquisition d’un fonds professionnel libéral par une société de géomètres-experts. L’opération, financée par un crédit consenti par un établissement bancaire en décembre 2012, est garantie par un cautionnement d’un établissement professionnel. Quelques jours plus tôt, deux personnes physiques ont accepté de devenir sous-cautions en garantissant donc la société caution, et ce, pour des montants respectivement d’un million d’euros et de deux millions d’euros.
Par jugement du 24 janvier 2017, la société débitrice principale est placée en procédure de sauvegarde. Dans le même temps, la caution est appelée à régler la créance de la banque. Le 5 avril 2018, le garant décide donc de se retourner contre ses sous-cautions pour le montant du plafond de la première caution (soit un million d’euros) et pour une somme de 1 097 445,55 € pour la seconde.
Le 25 septembre 2018, un plan de sauvegarde est arrêté au profit de la débitrice principale.
Un litige se noue autour du paiement par les sous-cautions des sommes exigées par la caution au titre de l’engagement pris par ces deux dernières à son égard. Notons – et ça sera fondamental pour la suite – que l’assignation délivrée par la caution est antérieure au plan de sauvegarde.
En cause d’appel, l’engagement de la première sous-caution est considéré comme disproportionné au sens de l’ancien article L. 341-4 devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation. Cependant, puisque la sous-caution concernée pouvait faire face à son engagement au moment où elle a été appelée à régler la créance, elle est condamnée au paiement. Quant à la seconde sous-caution, elle doit régler la somme de 1 097 455,55 € avec capitalisation annuelle des intérêts.
Les sous-cautions se pourvoient en cassation. Les deux arrêts rendus par la chambre commerciale le 9 juillet 2025 aboutiront au rejet respectif des pourvois dans ces différentes affaires. Assez curieusement, seul l’un des deux arrêts est publié au Bulletin (comp., Com. 9 juill. 2025, n° 23-23.858 F-D). Étudions pourquoi la solution dessinée est importante.
Sous-cautionnement et plan de sauvegarde du débiteur
L’enjeu de la question réside dans la conception de la disproportion du cautionnement antérieurement au 1er janvier 2022. L’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1, du code de la consommation permettait, en effet, de contraindre la caution à régler le créancier même si son engagement était disproportionné au moment de la conclusion de la sûreté. Pour ce faire, encore fallait-il prouver le retour à meilleure fortune du garant, i.e. la possibilité pour lui de faire face à son obligation au jour où il était appelé à régler le créancier. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a supprimé cette exception en rattachant la proportionnalité à la formation du contrat lui-même (v. P. Simler et P. Delebecque, Droit des sûretés et de la publicité foncière, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2023, p. 131, n° 124).
Or, toute la difficulté de l’espèce réside dans le plan de sauvegarde adopté le 25 septembre 2018. L’article L. 626-11 du code de commerce permet de rendre opposable ledit plan au garant personnel, personne physique. Que penser, toutefois, de la sous-caution qui souhaiterait opposer ce plan de sauvegarde pour refuser le paiement ? Doit-on, en d’autres termes, opérer une distinction entre elle et la caution au sens de l’article L. 626-11 précédemment mentionné ?
Comme nous l’avons déjà rappelé dans l’introduction du présent commentaire, la chambre commerciale a, au printemps dernier, précisé par exemple que la sous-caution ne pouvait bénéficier d’un devoir de mise en garde qui serait dû par la caution professionnelle (Com. 2 avr. 2025, n° 23-22.311, préc.). Nous avions, dans ces colonnes, relevé que cette position ne nous semblait pas pleinement convaincante et qu’elle serait en tout état de cause contestée par la formulation de l’article 2299 nouveau du code civil. Comme le relève un auteur, la spécialisation du sous-cautionnement n’est pas souhaitable car cette opération n’est « rien d’autre qu’un cautionnement » (Y. Blandin, Réforme du droit des sûretés, Lextenso, 2022, p. 24 ; C. civ., art. 2291-1 nouv., nous soulignons).
L’opposabilité du plan de sauvegarde à la sous-caution, nerf de la guerre de l’affaire examinée aujourd’hui, permet de croiser ces réflexions à l’aune du droit des entreprises en difficulté. C’est parce que la sous-caution ne fait que garantir la caution de son recours personnel contre le débiteur principal que l’hésitation est permise. En d’autres termes, la sous-caution n’a pas de rapport contractuel avec ledit débiteur principal. Il pourrait ainsi être difficile de considérer le plan de sauvegarde opposable par la sous-caution dans ce contexte. Cependant, il n’en reste pas moins que la trame de fond de l’opération demeure centrée autour de l’obligation initiale, de près ou de loin. En considérant les différentes sûretés dans un même ensemble, le cautionnement étant nécessairement en synergie avec le sous-cautionnement, l’opposabilité du plan de sauvegarde par la sous-caution pourrait au moins se défendre.
La chambre commerciale a toutefois décidé de trancher en faveur d’une solution prudente.
Un raisonnement en cascade
On distinguera l’opposabilité du plan de sauvegarde de l’appréciation de la disproportion.
La sous-caution ne peut pas se prévaloir du plan de sauvegarde du débiteur principal
La Cour de cassation énonce ainsi que la sous-caution « ne peut donc opposer à la caution, qui s’est fait garantir le remboursement de sommes payées par elle au créancier, le plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal » (pt n° 14, nous soulignons). Selon son argumentation, la sous-caution ne peut pas utiliser à son profit les exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard de son créancier. La justification tenue ressemble, peu ou prou, à ce qui avait été construit dans l’arrêt du 2 avril 2025 précité en figeant la démonstration sur la diversité des créances garanties, à savoir celle du débiteur principal pour la caution ainsi que celle de la caution se retournant contre ledit débiteur principal pour la sous-caution.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, des arguments en sens contraire s’opposent. La réponse donnée a au moins l’honneur de distinguer les opérations sous le prisme de l’objet de la garantie donnée. Toutefois, tout ceci revient inéluctablement à faire peser un poids très important sur la sous-caution qui se retrouve démunie en pareille situation. La présence d’un sous-cautionnement sécurise nécessairement la caution dans son recours personnel mais la sous-caution n’est pas pour autant un codébiteur solidaire, elle ne doit rien supporter au stade définitif. En théorie, du moins car l’ensemble de ces solutions aboutit in fine à reporter le risque de l’insolvabilité sur celui en bout de chaîne. Soit, la sous-caution en l’espèce.
La précision est, quoi qu’il en soit, très importante pour la pratique et il faut donc désormais la retenir. La sous-caution ne peut, purement et simplement, pas utiliser le plan arrêté au profit du débiteur principal. La solution devrait être reprise en droit nouveau. Du moins, aucune disposition issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés ne vient directement en contester l’orientation pour les sous-cautionnements postérieurs au 1er janvier 2022.
Quand apprécier l’exception de meilleure fortune ?
Reste cependant à savoir si les engagements de chaque sous-caution sont considérés comme disproportionnés ou non. Ceci pose la question de la temporalité de l’appréciation du retour à meilleure fortune de l’ancien article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1, du code de la consommation. Les deux sous-cautions arguaient que leur patrimoine ne pouvait être correctement analysé qu’au jour où le plan n’était plus respecté. Ce que la chambre commerciale reconnaît sans difficulté en combinant cette disposition du code de la consommation avec l’article L. 626-11 du code de commerce (pt n° 16). Cette position se comprend assez facilement dans la mesure où l’engagement du garant n’est exigible ici que lorsque le débiteur principal est défaillant. Il est purement et simplement impossible de savoir si cette possibilité de faire face à l’obligation est constituée antérieurement puisque ledit garant n’est pas encore appelé.
Il n’en reste pas moins qu’un tel arsenal juridique peut étonner. Il est, en effet, rappelé que l’assignation introductive de la caution à ses sous-cautions a été délivrée antérieurement au plan de sauvegarde. Par conséquent, la disproportion de l’engagement ne peut être appréciée qu’au jour de l’assignation sans que le plan ne joue en la matière eu égard aux développements précédents, la sous-caution ne pouvant pas s’en prévaloir. Fallait-il tout de même opérer de telles précisions en pareille circonstance ? La chambre commerciale fait probablement ici œuvre de pédagogie pour distinguer les situations et enrayer l’apparition de nouveaux problèmes à l’avenir.
En tout état de cause, la solution permet de révéler encore davantage la dangerosité du sous-cautionnement. En garantissant la créance de la caution, qui souhaite à juste titre obtenir le remboursement des sommes réglées, la sous-caution ne peut pas opposer le plan de sauvegarde. Et puisque l’assignation est antérieure à l’adoption du plan, la disproportion doit être alors arrêtée au jour de l’acte introductif d’instance. Si le garant peut faire face à son obligation ce jour-là, il doit en répondre eu égard à l’architecture du texte désormais abrogé du code de la consommation. Ce problème intéressera évidemment la pratique mais puisque l’exception de retour à meilleure fortune est supprimée dans le nouvel article 2299 du code civil, les difficultés viendront se tarir au fur et à mesure.
Voici un arrêt aussi complet qu’important. Sa portée est intimement liée à la configuration du sous-cautionnement. Cette garantie particulière n’en reste pas moins un cautionnement. Les solutions tracées par la Cour de cassation rendent l’opération, toutefois, de plus en plus spécialisée mais également de plus en plus efficace. D’où sa multiplication en pratique ces dernières années.
Com. 9 juill. 2025, F-B, n° 23-23.856
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille
© Lefebvre Dalloz