Sur la rétroactivité de la jurisprudence nouvelle et sa modulation a posteriori
Il n’y a pas lieu de différer l’application dans le temps de la règle selon laquelle la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués est dépourvue d’effet dévolutif. Son application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable.
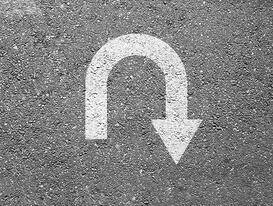
Au regard de la procédure civile, cet arrêt innove peu. C’est sous l’angle de l’application rétroactive de la jurisprudence nouvelle et de sa modulation a posteriori qu’il interroge et innove possiblement (sujet sur lequel le soussigné déclare avoir été récemment consulté). Cette problématique refait surface au cœur d’une actualité brûlante.
Nul n’ignore que la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré plusieurs revirements d’ampleur le 13 septembre 2023 s’agissant de l’acquisition des congés payés en période d’arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et du point de départ de la prescription du droit auxdits congés (Soc. 13 sept. 2023, n° 22-17.340 et n° 22-10.529, Dalloz actualité, 28 sept. 2023, obs. C. Martin ; Droit social 2023. 745, obs. C. Radé ; Rev. trav. 2023. 639, obs. M. Miné ; D. 2023. 1936 ![]() ; D. 2023. 1936
; D. 2023. 1936 ![]() , note R. Tinière
, note R. Tinière ![]() ; JA 2023, n° 686, p. 11, obs. A. Kras
; JA 2023, n° 686, p. 11, obs. A. Kras ![]() ; RDT 2023. 639, chron. M. Miné
; RDT 2023. 639, chron. M. Miné ![]() ). Or la rétroactivité de cette jurisprudence – si elle est avérée – inquiète légitimement les milieux économiques.
). Or la rétroactivité de cette jurisprudence – si elle est avérée – inquiète légitimement les milieux économiques.
C’est que l’effet conjugué de la rétroactivité de la jurisprudence et du report du point de départ de la prescription à la date où le salarié a été effectivement mis en mesure d’exercer ses droits pourrait conduire à une dette colossale des employeurs. Et cela alors même qu’ils se sont scrupuleusement conformés à la loi française et à la jurisprudence antérieure de la chambre sociale, et qu’ils ne pouvaient sérieusement prévoir un revirement d’une telle ampleur, qui procède d’un raisonnement nouveau donnant indirectement un effet horizontal à une directive européenne (R. Tinière, Charte des droits fondamentaux de l’UE et droits à congé payé du salarié en arrêt de maladie, D. 2023. 1936). Si les employeurs pouvaient à la rigueur anticiper une intervention législative – à effet prospectif –, ils pouvaient plus difficilement prédire un tel retournement de jurisprudence – à effet rétroactif.
Dans un ordre d’idée proche, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée le 9 novembre 2023 sur la rétroactivité de la fameuse jurisprudence Czabaj en contentieux administratif (CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Dalloz actualité, 19 juill. 2016, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon avec les conclusions ![]() ; AJDA 2016. 1479
; AJDA 2016. 1479 ![]() ; ibid. 1629
; ibid. 1629 ![]() , chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet
, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ![]() ; AJFP 2016. 356, et les obs.
; AJFP 2016. 356, et les obs. ![]() ; AJCT 2016. 572
; AJCT 2016. 572 ![]() , obs. M.-C. Rouault
, obs. M.-C. Rouault ![]() ; RDT 2016. 718, obs. L. Crusoé
; RDT 2016. 718, obs. L. Crusoé ![]() ; RFDA 2016. 927, concl. O. Henrard
; RFDA 2016. 927, concl. O. Henrard ![]() ; RTD com. 2016. 715, obs. F. Lombard
; RTD com. 2016. 715, obs. F. Lombard ![]() ) et en particulier à son application immédiate aux instances en cours, qui a concrètement conduit à « claquer la porte » du prétoire au nez de certains litigants (CEDH 9 nov. 2023, Legros e.a. c/ France, n° 72173/17 et 17 autres requêtes). Toute la question était de savoir si l’application immédiate des règles relatives aux délais de recours issues de ce revirement à des procédures pendantes, conduisant au rejet des recours estimés tardifs, a porté atteinte au droit d’accès au juge des requérants. La réponse est désormais connue : condamnation de la France à l’unanimité sur le fondement principal de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Un simple extrait donne le ton : « la Cour considère que l’application aux instances en cours de la nouvelle règle de délai de recours contentieux, qui était pour les requérants à la fois imprévisible, dans son principe, et imparable, en pratique, a restreint leur droit d’accès à un tribunal à un point tel que l’essence même de ce droit s’en est trouvée altérée » (§ 162).
) et en particulier à son application immédiate aux instances en cours, qui a concrètement conduit à « claquer la porte » du prétoire au nez de certains litigants (CEDH 9 nov. 2023, Legros e.a. c/ France, n° 72173/17 et 17 autres requêtes). Toute la question était de savoir si l’application immédiate des règles relatives aux délais de recours issues de ce revirement à des procédures pendantes, conduisant au rejet des recours estimés tardifs, a porté atteinte au droit d’accès au juge des requérants. La réponse est désormais connue : condamnation de la France à l’unanimité sur le fondement principal de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Un simple extrait donne le ton : « la Cour considère que l’application aux instances en cours de la nouvelle règle de délai de recours contentieux, qui était pour les requérants à la fois imprévisible, dans son principe, et imparable, en pratique, a restreint leur droit d’accès à un tribunal à un point tel que l’essence même de ce droit s’en est trouvée altérée » (§ 162).
Toujours dans la même veine, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment opéré un revirement important en matière concurrentielle : la saisine d’une juridiction non spécialisée se paie à présent d’une incompétence de la juridiction et non d’une irrecevabilité de la demande dérivant du défaut de pouvoir juridictionnel (Com. 18 oct. 2023, n° 21-15.378, Dalloz actualité, 7 nov. 2023, obs. M. Barba ; ibid., 8 nov. 2023, obs. M. Barba ; D. 2023. 1853 ![]() ). Mais la rétroactivité de ce revirement pose question. Imaginons qu’antérieurement au revirement, une partie ait élevé une fin de non-recevoir sur la foi de la jurisprudence antérieure. Apprenant le revirement, elle devrait à présent élever une exception d’incompétence. Or l’exception d’incompétence est à soulever in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (C. pr. civ., art. 74). Elle sera donc irrecevable (en première instance comme en appel). L’ironie est là : en se conformant à la jurisprudence antérieure, cette partie s’est condamnée à ne pas pouvoir respecter la jurisprudence nouvelle. Et la juridiction saisie n’y pourra rien car son office est limité (v. M. Barba, Saisine d’une juridiction non spécialisée en droit des pratiques restrictives : l’incompétence plutôt que l’irrecevabilité (Les hésitations), Dalloz actualité, 8 nov. 2023).
). Mais la rétroactivité de ce revirement pose question. Imaginons qu’antérieurement au revirement, une partie ait élevé une fin de non-recevoir sur la foi de la jurisprudence antérieure. Apprenant le revirement, elle devrait à présent élever une exception d’incompétence. Or l’exception d’incompétence est à soulever in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (C. pr. civ., art. 74). Elle sera donc irrecevable (en première instance comme en appel). L’ironie est là : en se conformant à la jurisprudence antérieure, cette partie s’est condamnée à ne pas pouvoir respecter la jurisprudence nouvelle. Et la juridiction saisie n’y pourra rien car son office est limité (v. M. Barba, Saisine d’une juridiction non spécialisée en droit des pratiques restrictives : l’incompétence plutôt que l’irrecevabilité (Les hésitations), Dalloz actualité, 8 nov. 2023).
De tout cela, il ressort que la rétroactivité de la jurisprudence nouvelle interroge. La deuxième chambre civile apporte sa pierre à l’édifice au moyen du présent arrêt.
L’histoire est d’une banalité confondante. Un litigant régularise une déclaration d’appel sans préciser les chefs de jugement critiqués. La déclaration précisait simplement : « appel sur toutes les dispositions du jugement ». La cour d’appel n’en a pas pris ombrage et a jugé que l’effet dévolutif jouait à la façon d’un appel général, i.e. pour la totalité du dispositif du jugement déféré. Pourvoi est formé et bien formé.
La question n’est pas de savoir si les chefs de jugement critiqués doivent figurer dans la déclaration d’appel à peine d’absence d’effet dévolutif : la réponse – positive et réitérée au paragraphe 4 – est acquise depuis l’arrêt du 30 janvier 2020 (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-22.528, Dalloz actualité, 17 févr. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 288 ![]() ; ibid. 576, obs. N. Fricero
; ibid. 576, obs. N. Fricero ![]() ; ibid. 1065, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle
; ibid. 1065, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle ![]() ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero
; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero ![]() ; D. avocats 2020. 252, étude M. Bencimon
; D. avocats 2020. 252, étude M. Bencimon ![]() ; RTD civ. 2020. 448, obs. P. Théry
; RTD civ. 2020. 448, obs. P. Théry ![]() ; ibid. 458, obs. N. Cayrol
; ibid. 458, obs. N. Cayrol ![]() ) ; ce n’est pas à la veille d’une réforme de l’appel civil que la Cour de cassation risque de revirer.
) ; ce n’est pas à la veille d’une réforme de l’appel civil que la Cour de cassation risque de revirer.
La question n’est pas davantage de savoir de quelle manière la régularisation s’opère. Si un récent arrêt a pu jeter le doute (Civ. 2e, 14 sept. 2023, n° 21-22.783, Dalloz actualité, 12 oct. 2023, obs. R. Laffly ; D. 2023. 1654 ![]() ; AJ fam. 2023. 480, obs. F. Eudier
; AJ fam. 2023. 480, obs. F. Eudier ![]() ), la règle est aujourd’hui connue : c’est par une nouvelle déclaration d’appel rectificative réalisée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond que celui-ci peut régulariser (§ 5).
), la règle est aujourd’hui connue : c’est par une nouvelle déclaration d’appel rectificative réalisée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond que celui-ci peut régulariser (§ 5).
La question n’est même pas celle de la conformité de ces règles au droit au procès équitable car, là aussi, la réponse de la deuxième chambre civile est connue de longue date (§ 7 ; v. ant. les §§ 7 s. de l’arrêt du 30 janv. 2020). La question de droit n’est pas là.
La véritable question est de savoir si ces règles procédurales sont d’application immédiate aux instances en cours au 30 janvier 2020, date de la jurisprudence séminale, étant précisé qu’en l’espèce, l’appel avait été régularisé le 7 janvier 2019. Voici la réponse de la Cour de cassation :
« Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d’ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable. Il n’y a, dès lors, pas lieu de différer les effets de celles-ci. » (§ 6)
C’est, dès lors, sans surprise que la Cour de cassation annule l’arrêt d’appel puis statue au fond en disant que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande en l’absence d’effet dévolutif de l’appel. La cassation est prononcée sans renvoi (v. réc. sur ce sujet, A. Tani, Cassation avec ou sans renvoi ?, RTD civ. 2023. 517 ![]() ).
).
La Cour de cassation réitère ainsi ce qui s’évinçait déjà d’un précédent arrêt inédit et passé inaperçu en doctrine (Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-20.706), à savoir qu’elle n’a pas l’intention de moduler a posteriori les effets de sa jurisprudence du 30 janvier 2020.
Mais au-delà de ce résultat négatif, cela signifie-t-il qu’il est par principe possible pour la Cour de cassation de moduler a posteriori une jurisprudence antérieure ? La réponse est à notre sens positive. Ce qui conduit à une seconde interrogation : quelles sont les conditions de cette modulation a posteriori ?
Le principe de la modulation a posteriori
La jurisprudence est par principe rétroactive. Ce n’est que par exception qu’elle est prospective, c’est-à-dire ne dispose que pour l’avenir. Non sans paradoxe, la règle est inversée par rapport à celle qui gouverne l’application dans le temps de la loi et des règlements, qui ne disposent par principe que pour l’avenir et ne rétroagissent que par exception.
Quand la jurisprudence est-elle à effet prospectif ? C’est ordinairement le revirement de jurisprudence qui donne lieu à modulation (M. Barba, Appel du refus de désigner un expert en vue de l’évaluation des droits sociaux – Histoire d’un revirement, avenir du revirement, D. 2022. 1291, nos 22 s. et les réf. ![]() ). Cela étant, lorsqu’une jurisprudence simplement nouvelle (i.e. non issue d’un revirement) surprend fortement, sa modulation peut aussi être envisagée : soit au moyen d’un différé général, comme le montre le fameux exemple de l’obligation de mentionner une prétention à la réformation ou à l’annulation au dispositif des conclusions d’appel (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626, Dalloz actualité, 1er oct. 2020, obs. C. Auché et N. de Andrade ; D. 2020. 2046
). Cela étant, lorsqu’une jurisprudence simplement nouvelle (i.e. non issue d’un revirement) surprend fortement, sa modulation peut aussi être envisagée : soit au moyen d’un différé général, comme le montre le fameux exemple de l’obligation de mentionner une prétention à la réformation ou à l’annulation au dispositif des conclusions d’appel (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626, Dalloz actualité, 1er oct. 2020, obs. C. Auché et N. de Andrade ; D. 2020. 2046 ![]() , note M. Barba
, note M. Barba ![]() ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero
; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero ![]() ; ibid. 1353, obs. A. Leborgne
; ibid. 1353, obs. A. Leborgne ![]() ; AJ fam. 2020. 536, obs. V. Avena-Robardet
; AJ fam. 2020. 536, obs. V. Avena-Robardet ![]() ; D. avocats 2020. 448 et les obs.
; D. avocats 2020. 448 et les obs. ![]() ; Rev. prat. rec. 2020. 15, chron. I. Faivre, A.-I. Gregori, R. Laher et A. Provansal
; Rev. prat. rec. 2020. 15, chron. I. Faivre, A.-I. Gregori, R. Laher et A. Provansal ![]() ; RTD civ. 2021. 479, obs. N. Cayrol
; RTD civ. 2021. 479, obs. N. Cayrol ![]() ; JCP 2020. 1281, note N. Cayrol ; ibid. Doctr. 1472, chron. L. Mayer ; Procédures 2020. Comm. 190, obs. R. Laffly ; Gaz. Pal. 26 janv. 2021, p. 79, obs. N. Hoffschir ; ibid. 82, obs. L. Lauvergnat, 8 déc. 2020, p. 41, obs. J.-J. Ansault et 27 oct. 2020, p. 9, obs. P. Gerbay) ; soit au moyen d’une modulation concrète, comme l’a montré l’exemple tout aussi fameux de la jurisprudence relative à la délégation adoptive en Polynésie française (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-50.042, Dalloz actualité, 7 oct. 2022, obs. E. Supiot ; D. 2022. 2134
; JCP 2020. 1281, note N. Cayrol ; ibid. Doctr. 1472, chron. L. Mayer ; Procédures 2020. Comm. 190, obs. R. Laffly ; Gaz. Pal. 26 janv. 2021, p. 79, obs. N. Hoffschir ; ibid. 82, obs. L. Lauvergnat, 8 déc. 2020, p. 41, obs. J.-J. Ansault et 27 oct. 2020, p. 9, obs. P. Gerbay) ; soit au moyen d’une modulation concrète, comme l’a montré l’exemple tout aussi fameux de la jurisprudence relative à la délégation adoptive en Polynésie française (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-50.042, Dalloz actualité, 7 oct. 2022, obs. E. Supiot ; D. 2022. 2134 ![]() , note M. Barba et G. Millerioux
, note M. Barba et G. Millerioux ![]() ; ibid. 2023. 523, obs. M. Douchy-Oudot
; ibid. 2023. 523, obs. M. Douchy-Oudot ![]() ; ibid. 807, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat
; ibid. 807, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ![]() ; AJ fam. 2023. 223
; AJ fam. 2023. 223 ![]() ; Rev. crit. DIP 2023. 227, note S. Chaillé de Néré
; Rev. crit. DIP 2023. 227, note S. Chaillé de Néré ![]() ; RTD civ. 2022. 877, obs. A.-M. Leroyer
; RTD civ. 2022. 877, obs. A.-M. Leroyer ![]() ; ibid. 2023. 63, obs. P. Deumier
; ibid. 2023. 63, obs. P. Deumier ![]() ; Dr. fam. 2022. 167, note M.-C. Le Boursicot).
; Dr. fam. 2022. 167, note M.-C. Le Boursicot).
Sans doute la modulation est-elle plus facilement envisageable à l’endroit d’un revirement, qui surprend généralement les justiciables ayant accordé crédit à la jurisprudence antérieure et ayant cru à sa longévité. Mais elle n’est pas exclue à l’endroit d’une jurisprudence simplement nouvelle. Ce qui conduit à la jurisprudence du 30 janvier 2020.
Cette jurisprudence selon laquelle la déclaration d’appel vide de chefs de jugement critiqués est dépourvue d’effet dévolutif fut une surprise, de l’avis général des commentateurs (v. not., R. Laffly, Bombe à retardement : la cour n’est pas saisie par l’acte d’appel sans mention des chefs de jugement critiqués, Dalloz actualité, 17 févr. 2020, qui fait le point sur la jurisprudence antérieure du fond et ses hésitations). À proprement parler, elle ne constitue pas un revirement. D’aucuns ont pu le penser car, en 2017, la Cour de cassation avait retenu que le défaut de mention des chefs de jugement critiqués devait être sanctionné par une nullité pour vice de forme (Cass., avis, 20 déc. 2017, nos 17-70.034, 17-70.035 et 17-70.036, D. 2018. 18 ![]() ; ibid. 692, obs. N. Fricero
; ibid. 692, obs. N. Fricero ![]() ; ibid. 757, chron. E. de Leiris, O. Becuwe, N. Touati et N. Palle
; ibid. 757, chron. E. de Leiris, O. Becuwe, N. Touati et N. Palle ![]() ; AJ fam. 2018. 142, obs. M. Jean
; AJ fam. 2018. 142, obs. M. Jean ![]() ). Mais elle s’était alors contentée de répondre à la question posée et de préciser la nature de la nullité encourue ; il n’était en revanche pas exclu que puisse s’ajouter une autre « sanction », pour ainsi dire, à savoir l’absence d’effet dévolutif, qu’on a pu nommer « insaisine » (G. Sansone, L’absence d’effet dévolutif, à la recherche d’une inconnue du droit, D. 2023. 1910
). Mais elle s’était alors contentée de répondre à la question posée et de préciser la nature de la nullité encourue ; il n’était en revanche pas exclu que puisse s’ajouter une autre « sanction », pour ainsi dire, à savoir l’absence d’effet dévolutif, qu’on a pu nommer « insaisine » (G. Sansone, L’absence d’effet dévolutif, à la recherche d’une inconnue du droit, D. 2023. 1910 ![]() ; G. Sansone, Les sanctions en procédure civile, LGDJ, coll. « Bibl. dr. privé », t. 627, 2023, n° 338, p. 356).
; G. Sansone, Les sanctions en procédure civile, LGDJ, coll. « Bibl. dr. privé », t. 627, 2023, n° 338, p. 356).
La jurisprudence du 30 janvier 2020 n’est donc pas constitutive d’un revirement. Elle constitue une jurisprudence simplement nouvelle. Et encore : elle n’innove pas sur le moyen de la régularisation qui était déjà, dans les avis de 2017, la déclaration d’appel rectificative à réaliser dans le délai imparti à l’appelant pour conclure (§ 8 de l’arrêt du 30 janv. 2020). Elle est donc partiellement nouvelle, pour ainsi dire. Cela n’exclut cependant pas sa modulation puisque, comme on l’a dit, la modulation n’est pas cantonnée aux hypothèses de revirement : elle est aussi envisageable à l’endroit d’une jurisprudence simplement nouvelle, pour peu que certaines conditions soient réunies (infra).
Le 30 janvier 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation n’a cependant pas fait le choix de la modulation, de sorte que tout laissait à penser que cette jurisprudence était rétroactive. D’ailleurs, dans un arrêt plutôt récent, la Cour de cassation a refusé de moduler a posteriori une autre jurisprudence antérieure, au motif expéditif que cette jurisprudence n’avait été assortie d’aucun différé d’application au moment de son adoption (Civ. 2e, 20 oct. 2022, n° 21-20.692). Comprendre : une jurisprudence nouvelle et non modulée au moment de son édiction ne peut être, par principe, modulée a posteriori.
Pourtant, et là est le premier apport notable de l’arrêt sur la question, la Cour de cassation se montre nettement moins expéditive dans l’arrêt rapporté. Elle ne se contente pas de souligner que l’arrêt du 30 janvier 2020 ne fut assorti d’aucun différé d’application ; elle prend plutôt le soin de montrer en quoi il n’est pas requis, au 26 octobre 2023, de différer dans le temps les effets de sa jurisprudence du 30 janvier 2020. C’est dire que la Cour de cassation admet l’idée même que sa jurisprudence puisse être modulée a posteriori, ce qui est tout à fait remarquable.
En vérité, la Cour de cassation a déjà modulé dans le temps les effets de sa propre jurisprudence a posteriori (Civ. 2e, 8 déc. 2022, n° 21-14.144, Dalloz actualité, 13 janv. 2023, obs. C. Bléry ; modulant Civ. 2e, 14 avr. 2022, n° 19-19.059 ; Civ. 1re, 11 mai 2012, n° 10-28.032 modulant et rabattant même Civ. 1re, 28 mars 2012, n° 10-28.032, Dalloz actualité, 3 mai 2012, obs. C. Tahri ; ibid., 5 oct. 2012, obs. M. Kebir ; rapp. Com. 26 oct. 2010, n° 09-68.928, Dalloz actualité, 4 nov. 2010, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2011. 359, note N. Morelli ![]() ; approuvant la modulation de Cass., ch. mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413, D. 2007. 1414
; approuvant la modulation de Cass., ch. mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413, D. 2007. 1414 ![]() , obs. A. Lienhard
, obs. A. Lienhard ![]() ; Rev. sociétés 2007. 620, note J.-F. Barbièri
; Rev. sociétés 2007. 620, note J.-F. Barbièri ![]() ; RTD com. 2007. 550, obs. M.-H. Monsèrié-Bon
; RTD com. 2007. 550, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ![]() ; ibid. 597, obs. A. Martin-Serf
; ibid. 597, obs. A. Martin-Serf ![]() ).
).
Concrètement, elle adopte une certaine jurisprudence à un instant t, sans se prononcer sur sa rétroactivité, puis réalise ultérieurement sa modulation. Généralement, c’est de modulation concrète qu’il s’agit : la Cour de cassation admet que la règle issue de la jurisprudence nouvelle antérieure puisse n’être pas appliquée dans un certain cas d’espèce. Cependant, dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation envisage un autre type de modulation : « Il n’y a, dès lors, pas lieu de différer les effets » des règles procédurales en cause (§ 6). L’emploi du terme « différer » est notable.
Est-ce à dire que la Cour de cassation admet non seulement la figure de la modulation concrète a posteriori (inapplication au cas d’espèce) mais aussi celle de la modulation abstraite a posteriori (différé d’application général) ? C’est tentant. Et envisageable, même si la réflexion vire alors au casse-tête car c’est bien en vertu de sa rétroactivité naturelle que la jurisprudence postérieure opère la modulation d’une jurisprudence antérieure. Très concrètement, cela revient à neutraliser a posteriori et généralement la rétroactivité d’une jurisprudence antérieure (appliqué à la jurisprudence du 30 janv. 2020, cela reviendrait par exemple à réserver son application aux appels postérieurement relevés et ce en vertu, non de l’arrêt du 30 janv. 2020 mais d’un arrêt postérieur).
Au moyen de l’arrêt rapporté, la deuxième chambre civile innove donc possiblement deux fois : elle admet implicitement la possibilité d’une modulation de jurisprudence a posteriori (même si elle la refuse en l’occurrence) ; elle envisage aussi, quoique moins nettement, la possibilité d’une modulation de jurisprudence a posteriori de facture abstraite, c’est-à-dire au moyen d’un véritable différé d’application (même si, encore une fois, elle la refuse en l’occurrence).
Cela pour dire qu’il n’est pas exclu, en présence d’une jurisprudence nouvelle non modulée dès l’origine, d’en requérir ultérieurement la modulation. Qu’en penser ? D’un côté, on peine à penser qu’une jurisprudence postérieure puisse moduler dans le temps les effets d’une jurisprudence antérieure, de sorte que la rétroactivité de la première viendrait atteindre celle de la seconde. D’un autre côté, outre que la Cour de cassation l’a déjà fait, rien ne s’y oppose sur le principe, pour peu que l’usage d’une telle prérogative soit parcimonieux. Il arrive sans doute que les juges du quai de l’Horloge n’envisagent pas – voire ne puissent envisager – tous les effets de l’application immédiate et rétroactive de leur jurisprudence.
Dès lors, ne faut-il pas admettre la possibilité de moduler son application dans le temps a posteriori, lorsque la situation le justifie ? Voilà qui conduit à examiner les conditions d’une pareille modulation a posteriori.
Les conditions de la modulation a posteriori
Nul n’a droit au maintien d’une jurisprudence figée (v. not., Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-20.706, § 4, préc.). Celle-ci doit pouvoir advenir et évoluer, par précision ou revirement – le nuancier étant infini. En revanche, il ne doit pas systématiquement être fait application immédiate et rétroactive de la jurisprudence nouvelle lorsque le justiciable de bonne foi a agi en conformité avec l’état apparent du droit antérieur, dans la croyance légitime de sa véracité, ou en conformité avec la jurisprudence ancienne, dans la croyance légitime de sa longévité (P. Deumier utilise l’expression englobante et opportune de « foi accordée au droit », v. RTD civ. 2023. 63 ![]() ). Ce sont les principes de sécurité juridique et de confiance légitime qui justifient au premier chef la modulation (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-50.042, § 27, préc.).
). Ce sont les principes de sécurité juridique et de confiance légitime qui justifient au premier chef la modulation (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-50.042, § 27, préc.).
Le respect des droits fondamentaux des litigants, au premier rang desquels le droit au procès équitable, peut concurremment conduire au même résultat, lorsque l’application immédiate de la jurisprudence nouvelle les prive du droit d’accès au juge (M. Barba, Appel civil : une main de fer dans un gant de velours, D. 2020. 2046 ![]() ). Le respect d’autres droits fondamentaux peut aussi bien conduire à la modulation (M. Barba et G. Millerioux, La délégation adoptive polynésienne sous le regard de la Cour de cassation, D. 2022. 2134, nos 14 s.
). Le respect d’autres droits fondamentaux peut aussi bien conduire à la modulation (M. Barba et G. Millerioux, La délégation adoptive polynésienne sous le regard de la Cour de cassation, D. 2022. 2134, nos 14 s. ![]() ).
).
Dans l’arrêt rapporté, la deuxième chambre civile refuse la modulation a posteriori sur le fondement d’une condition classique, à savoir la prétendue prévisibilité des règles issues de la jurisprudence du 30 janvier 2020, pour démontrer que la foi de l’appelant en l’état apparent du droit antérieur n’est pas digne de protection :
« Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d’ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable. » (§ 6).
Mettons à l’épreuve cette affirmation.
La règle, selon laquelle la déclaration d’appel vide de chefs de jugement critiqués est dépourvue d’effet dévolutif lorsqu’elle tend à la réformation du jugement, résulte-t-elle « clairement des textes applicables » ? Tout d’abord, on fera observer qu’en dépit de ce que laisse à penser la deuxième chambre civile, l’article 562 du code de procédure civile ne l’indique pas aussi clairement. Cet article se prête à de multiples interprétations qui ont eu cours dans la jurisprudence du fond, dont celle – antérieure au 30 janvier 2020 – qui consiste à penser qu’il doit être interprété à la lumière de l’article 901 du même code, qui indique comme seule sanction au défaut d’indication des chefs de jugement critiqués la nullité de la déclaration d’appel. Il ne résulte donc pas clairement des textes applicables que la déclaration vide de chefs de jugement critiqués est dépourvue d’effet dévolutif. La vérité est qu’il aura fallu l’arrêt du 30 janvier 2020 – savamment éclipsé – pour le savoir. Ce qui militerait plutôt en faveur de la modulation.
La règle, selon laquelle la déclaration d’appel irrégulière peut être régularisée dans le seul délai imparti à l’appelant pour conclure, résulte-t-elle « clairement des textes applicables » ? La Cour vise l’article 901, 4°, du code de procédure civile. On mettra au défi qui que ce soit de déduire de ce seul texte que la déclaration d’appel irrégulière ne peut être régularisée qu’au moyen d’une nouvelle déclaration à réaliser dans le délai imparti à l’appelant pour conclure. D’ailleurs, et l’ironie est là, la Cour de cassation vise ordinairement l’article 910-4, alinéa 1, pour fonder cette règle (v. le § 8 de l’arrêt du 30 janv. 2020) et non l’article 901, 4°.
Qu’à cela ne tienne : aucun de ces deux textes n’est satisfaisant. L’article 901, 4°, intéresse le formalisme de la déclaration d’appel. Quant à l’article 910-4, alinéa 1, il est le siège du principe de concentration des prétentions aux premières écritures en cause d’appel. Et nul n’a jamais réussi à expliquer sérieusement le lien entre son contenu et la possibilité restrictive de régularisation par déclaration d’appel rectificative dans le délai imparti à l’appelant pour conclure. C’est que la règle ne résulte pas des textes ; elle est tout entière le produit de la jurisprudence issue des avis de 2017 et de l’arrêt du 30 janvier 2020. Ce que la deuxième chambre civile éclipse encore.
Il y a ainsi une hypocrisie très apparente dans la motivation. La Cour de cassation n’a d’évidence pas le pouvoir de moduler dans le temps l’application des textes – les articles 562 et 901 du code de procédure civile en l’occurrence. Elle n’a que le pouvoir de moduler dans le temps l’application de sa propre jurisprudence – celle du 30 janvier 2020 –, qu’elle passe pourtant méthodiquement sous silence. Pourquoi ? Parce que reconnaître formellement, dans l’arrêt rapporté, l’existence même de cette jurisprudence l’aurait conduite à admettre la nécessité de cette dernière : sans cette jurisprudence, la règle procédurale n’aurait pas été connue ; ce qui conduisait tout droit à accréditer la thèse de sa modulation. Alors, pour refuser la modulation, la Cour de cassation préfère escamoter sa jurisprudence pour laisser à penser que la règle ne procède que des textes, ce qui ne convainc guère. On notera qu’elle use d’un procédé argumentatif exactement inverse s’agissant de la jurisprudence du 17 septembre 2020, en rappelant itérativement qu’avant la date de cet arrêt publié, nul ne pouvait sérieusement avoir connaissance de la règle procédurale qu’elle a instaurée (v. réc., Civ. 2e, 29 juin 2023, n° 22-14.432, § 11, Dalloz actualité, 13 sept. 2023, obs. R. Laffly ; D. 2023. 1268 ![]() ).
).
L’affirmation de la Cour de cassation – qui la conduit à refuser la modulation a posteriori – ne convainc donc pas. La règle issue de la jurisprudence du 30 janvier 2020 n’était pas sérieusement prévisible. Idéalement, il eût fallu en différer d’emblée l’application dans le temps. Il n’était néanmoins pas trop tard, croyons-nous, pour rectifier le tir a posteriori. La deuxième chambre s’y refuse hélas.
Au-delà de la procédure civile, le message général est net : la modulation a posteriori d’une jurisprudence antérieure n’est pas exclue lorsque la règle prétorienne qui en est issue n’était pas sérieusement prévisible avant son édiction. Peut-être la jurisprudence sociale évoquée en introduction fournira-t-elle à la Cour de cassation l’occasion d’en faire la démonstration.
© Lefebvre Dalloz