Synthèse annuelle du PNF pour 2024, politiques pénales en cours et possibles réformes législatives en 2025 : quand l’anticorruption revient sur le devant de la scène
La publication, le 24 janvier dernier, de la synthèse annuelle du parquet national financier (PNF) intervient quelques mois après la célébration des dix ans de ce parquet hautement spécialisé, et alors que le sujet de l’anticorruption revient dans l’actualité par le biais de la lutte renouvelée contre la criminalité organisée.
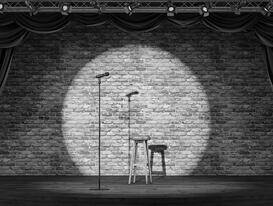
Un regard du PNF sur le passé récent : une certaine stabilité
Le bilan annuel pour 2024 (couplé avec le discours prononcé quelques jours plus tôt par le procureur de la République financiers lors de l’audience solennelle de rentrée du TJ de Paris du 21 janv. 2025) contient tout d’abord plusieurs données chiffrées utiles aux praticiens, et notamment :
- 766 procédures en cours (ce qui est relativement stable par rapport à l’an dernier) dont 87 % en enquête préliminaire et 13 % en information judiciaire ;
- une répartition égale entre les dossiers d’atteintes à la probité et ceux d’atteintes aux finances publiques, représentant chacun un peu plus de 46 % du contentieux (avec en outre, beaucoup plus minoritaires, ceux d’atteintes aux marchés financiers et d’atteintes à la concurrence) ;
- 97 condamnations prononcées en 2024 (dont 40 % en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité [CRPC], procédure applicable à la fraude fiscale depuis la loi n° 2018-898 du 23 oct. 2018), ce qui est relativement stable par rapport à 2023, mais un taux de relaxe de 39 %, qui « inquiète » le PNF ;
- 2 conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) ont été signées puis validées en 2024 (contre 6 en 2023), et plusieurs sont en cours de négociation et seront « prochainement finalisées » ;
- sommes prononcées en faveur du Trésor public dans les procédures terminées en 2024 : 203,9 millions d’euros.
Le contentieux concerne surtout les personnes physiques, mais « les affaires relatives à la fiscalité des entreprises constituent pour le PNF une priorité en raison des enjeux financiers qui y sont associés et de leur particulière complexité ».
De manière plus globale, ces chiffres sont à mettre en perspective avec le bilan global des dix ans d’activité du PNF réalisé en fin d’année 2024 (plus de 3 200 procédures initiées, 532 personnes condamnées en première instance, dont 97 en CRPC, et 20 CJIP validées).
La synthèse annuelle comporte, en outre, plusieurs rappels de politique pénale faits par le procureur de la République financier :
- recours aux saisies-confiscations « dès que le cadre juridique l’y autorise » ;
- justice négociée : le PNF poursuit notamment sa « politique de recours raisonné à la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) » ; en effet, comme le rappelle régulièrement le PNF, si ce dernier s’est « pleinement emparé » de la CJIP, cette dernière n’est pas pour autant la panacée en termes de réponse pénale : le 9 décembre 2024, soit exactement huit ans après l’introduction en droit français de la CJIP par la loi dite « Sapin 2 », « seulement » vingt-deux CJIP avaient été conclues par le PNF (14 en matière d’atteintes à la probité, et 8 en matière de fraude fiscale et blanchiment), soit une moyenne globale de trois CJIP par an ; en outre, la publication des lignes directrices sur la mise en œuvre de la CJIP, il y a deux ans en janvier 2023, n’a pas foncièrement, à ce stade, changé les choses en termes de nombre de CJIP conclues, même si la prudence s’impose en la matière, faute de recul suffisant et au regard de la durée parfois importante des négociations en la matière.
Des développements particuliers sont consacrés à l’entraide pénale internationale qui doit être encore renforcée, sachant que depuis sa création, le PNF a ainsi transmis 868 demandes à ses partenaires à l’international, vers 88 États différents. Cela n’est pas surprenant en soi, la dimension transfrontalière des dossiers suivis par le PNF étant très souvent présente, eu égard à son champ de compétence.
Enfin, le sujet majeur du recueil de la preuve numérique est largement évoqué (d’ailleurs, deux postes d’assistants spécialisés ont été recrutés par le PNF dans ce dernier domaine), tout comme il l’avait été lors de la journée consacrée aux dix ans du PNF en octobre 2024.
Un regard du PNF sur l’avenir : une demande renouvelée de réformes
Selon le procureur de la République financier, la compétence matérielle du PNF pourrait « utilement être étendue à la présomption de blanchiment ou encore aux violations de sanctions internationales ».
En outre, le procureur a récemment suggéré d’autres pistes d’évolution législatives :
- extension du domaine d’application de la CJIP (dont le champ actuel, s’agissant de la CJIP en matière financière, recouvre la fraude fiscale et le blanchiment, la corruption et le trafic d’influence) à d’autres atteintes à la probité (recel de détournement de fonds publics, de favoritisme, de prise illégale d’intérêt), voire aux autres contentieux du PNF (boursier, droit de la concurrence) ;
- possibilité pour le PNF de saisir l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de la concurrence (ADLC) sur réquisition, pour les associer aux enquêtes pénales ;
- refonte du régime des nullités de procédure.
Enfin, à l’occasion du colloque organisé par la Cour de cassation le 20 décembre 2024 et consacré au « renouveau du droit pénal de la concurrence », le procureur a considéré que la réforme opérée par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 – laquelle a donné une compétence concurrente au PNF pour les infractions en matière d’entente et d’abus de position dominante – était inachevée (l’objectif de répression accrue en matière de droit de la concurrence requérant un « écosystème mieux adapté »), et a proposé en conséquence :
- une reformulation du texte d’incrimination de l’article L. 420-6 du code de commerce relatif aux incriminations en matière d’ententes et d’abus de position dominante (article qui devrait viser explicitement les personnes morales pour lever toute ambiguïté sur le sujet, le PNF considérant que le texte le permet déjà depuis que la loi de 2004 a généralisé la responsabilité des personnes morales, et relevant qu’un juge a récemment homologué une CRPC condamnant une personne morale à une peine sur le fondement de ce texte), et un rehaussement des peines encourues avec notamment, la création d’une peine d’amende à taux mobile (en pourcentage du chiffre d’affaire mondial de l’entreprise ou au double du produit de l’infraction) et d’une peine complémentaire d’exclusion des marchés publics ;
- un recours facilité aux techniques spéciales d’enquête ;
- une détection facilitée des infractions par l’instauration d’une diminution de peines pour les auteurs ou complices qui, en dénonçant les faits auxquels ils ont pris part, permettent de faire cesser l’infraction ou d’identifier les autres auteurs ou complices, ce mécanisme étant proche de celui de la clémence en droit de la concurrence ;
- une extension du champ de compétence de la CJIP pour les délits prévus par l’article L. 420-6 du code de commerce (ententes et d’abus de position dominante).
Un regard du PNF sur le présent : une politique pénale réajustée
Dans le discours d’audience solennelle de rentrée de la Cour d’appel de Paris le 13 janvier dernier, la procureure générale annonçait que « la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment qui lui sont associés constituera l’axe majeur de l’action du ministère public en cette année [2025] ».
Quelques jours plus tard, lors de l’audience de rentrée du Tribunal judiciaire de Paris, le procureur de la République financier indiquait en réponse que « Tel sera donc aussi l’objectif 2025 du PNF. L’accent sera mis sur les procédures présentant des liens forts avec la criminalité organisée : les atteintes à la probité liées au trafic de stupéfiants, la fraude fiscale commise par des organisations criminelles, l’action des réseaux d’initiés qui présentent désormais des liens étroits avec le crime organisé. Il s’agit d’une action qui s’inscrira dans la continuité (nous avons déjà en portefeuille des dossiers relevant de ces domaines), mais qui visera aussi à identifier de nouvelles cibles et à développer de nouvelles approches pour entraver l’action des groupes criminels, avec nos propres méthodes et nos outils spécifiques (levier fiscal, connaissance des marchés financiers, maîtrise des schémas de corruption, réseau partenarial pour la collecte de preuves)».
D’ailleurs, la première circulaire de politique pénale récemment signée par le nouveau garde des Sceaux, ministre de la Justice (Circ. du 27 janvier 2025, CRIM 2025-02-/E1-27/01/2025), est principalement axée sur la lutte contre les organisations criminelles et le narcotrafic.
Or, dans ce cadre, le sujet de la corruption n’est pas absent puisqu’il est rappelé que « Les magistrats, les greffiers, les forces de l’ordre, les élus, les personnels pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse sont désormais les victimes, de façon récurrente, d’actes de violence ou la cible de manœuvres d’intimidation et/ou de corruption que les réseaux criminels, organisés, protéiformes et transnationaux, sont amenés à déployer ».
La même circulaire prône aussi le recours au mécanisme de la présomption de blanchiment tel que prévu à l’article 324-1-1 du code de procédure pénale, ce qui n’est pas sans lien avec les propos du procureur de la République financier, rappelés supra, sur l’intérêt porté par le PNF à cet outil.
Un regard global pour 2025 : renforcer l’anticorruption au titre de la lutte contre la grande criminalité
Les liens entre corruption et criminalité organisée font l’objet de travaux de plus en plus fournis, à l’instar de la récente commission sénatoriale sur les narcotrafics (Commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier), qui a consacré beaucoup de développements à la corruption commise dans ce contexte.
Les recommandations dédiées à la lutte contre la corruption portaient notamment sur les aspects suivants :
- gérer le risque de corruption tout au long de la carrière des agents publics (cartographier le risque corruptif, à la fois à l’échelle d’une administration et à l’échelle de chaque agent, et cribler systématiquement et à échéance régulière les agents publics des services répressifs, de la douane et de l’administration pénitentiaire) ;
- ne pas céder au piège de la corruption de « basse intensité » (assurer la traçabilité des accès aux fichiers de la police et de la gendarmerie et développer un traitement automatisé pour détecter les utilisations suspectes, étendre la liste des incriminations de la criminalité organisée à la corruption, et développer des mesures de protection ad hoc pour les personnes approchées et menacées par les organisations criminelles).
En outre, dans son rapport d’activité pour 2023, l’Agence française anticorruption (AFA) a annoncé mettre en place un groupe de travail interministériel sur la criminalité organisée, visant à mieux appréhender le phénomène et partager les bonnes pratiques pour y faire face, tout en alertant sur certains secteurs à risque (comme le secteur portuaire).
Tirant la conséquence de ces constats, la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, tout juste votée en première lecture au Sénat, pourrait modifier quelques éléments de l’arsenal français anticorruption.
En effet, selon le texte voté le 4 février 2025, au titre de la « lutte contre la corruption liée au narcotrafic » :
- au titre des mesures de détection et de prévention :
- le service de renseignement financier TRACFIN pourrait être directement destinataire d’alertes au sens de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin 2 » (signalement dit « externe »), en lien avec l’accomplissement de ses missions de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme ;
- les enquêtes administratives prévues pour certains postes sensibles (CSI, art. L. 114-1) pourraient inclure les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption (ce qui, du reste, correspondrait à l’une des recommandations habituelles du Groupe d’États contre la corruption – GRECO) ;
- des points de contact uniques de signalement seraient mis en place au sein des administrations et des services publics « au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important », ainsi que des procédures de signalement dédiées ;
- une « action de formation dédiée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter » serait introduite dans la formation initiale des personnels de l’administration pénitentiaire ;
- le parquet aurait le devoir, en cas de raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, « de causer un trouble au fonctionnement du service », d’informer sans délai l’administration qui l’emploie ;
- des mesures spécifiques seraient prises en ce qui concerne les ports et activités portuaires, pour lesquels le risque de corruption est identifié comme important :
- insertion d’un volet dédié à la prévention de la « corruption liée à la criminalité organisée » dans les plans de sûreté des ports et des installations portuaires (C. transp., art. L. 5332-7 s.) ;
- mesures de prévention des « infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits », pouvant être prises par l’autorité administrative (exiger la mise à disposition d’images captées par un système de vidéosurveillance, …) ;
- ajout des personnes morales exploitant des installations portuaires comme assujetties à l’article 17 de la loi Sapin 2 (obligation de mise en place de programmes de conformité) ;
- au titre des mesures répressives :
- une circonstance aggravante de bande organisée serait ajoutée à l’incrimination de corruption privée (C. pén., art. 445-2-2 nouv.) ;
- les crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, délits de corruption d’agent privé ou sportif prévus aux articles 445-1 à 445-2-1 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale, seraient inclus dans le champ des infractions relevant des procédures dérogatoires en matière de criminalité organisée (C. pr. pén., art. 706-73 et 706-73-1).
Ces apports en matière d’anticorruption, qui pourraient encore évoluer au gré des débats législatifs, seront à suivre dans les prochaines semaines, tout comme l’adoption plusieurs fois annoncée (et autant de fois repoussée) du Plan national de lutte contre la corruption 2024-2027, que l’AFA a préparé depuis maintenant plus d’un an.
© Lefebvre Dalloz