Visite domiciliaire préventive en matière terroriste : usage juridictionnel des « notes blanches »
Une visite domiciliaire préventive peut reposer exclusivement sur une « note blanche » émanant des services de renseignement, si tant est que cette dernière remplisse certaines conditions. Le juge judiciaire doit, par ailleurs, vérifier la nécessité de la mesure à l’aune de l’actualité de la menace.
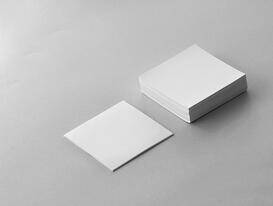
Le 6 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention (JLD) a été saisi d’une demande de visite des locaux d’une association, mesure prévue aux articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. La requête, émanant du préfet, reposait exclusivement sur une « note blanche » – note émanant d’un service de renseignement et ayant été « blanchie », c’est-à-dire dont les éléments permettant l’identification de la source et des moyens d’obtention des informations ont été retirés – et faisait état du comportement du co-président de l’association, qui présenterait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Le JLD autorise la visite par une ordonnance du 7 octobre 2021, qui fera l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’appel de Paris. Ce dernier confirme l’autorisation donnée par le JLD, aux motifs, d’une part, que le Conseil d’État a admis, à certaines conditions, le recours aux notes blanches à titre probatoire, et, d’autre part, que les différents éléments au fondement de la requête du préfet démontrent que les conditions de fond étaient bien remplies. L’association se pourvoit alors en cassation. Elle prétend, en premier lieu, qu’une note blanche ne peut, à elle seule, servir de fondement à une requête de visite domiciliaire, car le JLD doit pouvoir opérer une vérification du bien-fondé de la mesure en s’appuyant sur des éléments objectifs. Une note blanche devrait donc, nécessairement, être corroborée par d’autres éléments extrinsèques. Elle conteste, en second lieu, la teneur de la menace, puisque l’ensemble des éléments invoqués par le préfet sont anciens et ne suffisent donc pas à démontrer son caractère actuel. Au surplus, l’association évoque une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant le droit à la vie privée et familiale. La chambre criminelle rejette le pourvoi en validant en tous points le raisonnement opéré par le premier président de la Cour d’appel de Paris, et profite de l’occasion pour se positionner, pour la première fois, sur l’usage juridictionnel des notes blanches, tout en rappelant utilement les conditions de la visite domiciliaire préventive.
L’admission judiciaire du recours aux notes blanches en matière de prévention du terrorisme
Les notes blanches présentent l’avantage de permettre la communication à des personnes non habilitées au secret défense de certaines informations émanant des services de renseignement, sans compromettre le secret des sources (sur les notes blanches, v. B.-L. Combrade, Les notes blanches des services de renseignement, RFDA 2019. 1103 ![]() ). Si l’usage juridictionnel de ces notes a longtemps été résiduel, la mise en place de l’état d’urgence durant deux ans, à la suite des attentats du 13 novembre 2015, leur a grand ouvert les portes de la juridictionnalisation. En raison de la nature préventive des actes prévus par la loi de 1955 (Loi n° 55-385 du 3 avr. 1955 relative à l’état d’urgence, JO 7 avr.), le juge administratif s’est trouvé saisi de nombreuses mesures administratives restrictives de liberté (assignations à résidence, interdictions de séjour, dissolution d’associations, perquisitions administratives) reposant sur de telles notes. Le Conseil d’État a donc, très rapidement, élaboré de façon prétorienne une politique d’usage des notes blanches à titre probatoire en matière administrative, en soumettant leur caractère probant à trois conditions cumulatives : le contenu des notes doit être précis et circonstancié, les notes doivent avoir été versées au débat contradictoire, et, enfin, elles ne doivent pas faire l’objet d’une « contestation sérieuse » de la part du requérant (CE 11 déc. 2015, n° 394989, Dalloz actualité, 15 déc. 2015, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2015. 2404
). Si l’usage juridictionnel de ces notes a longtemps été résiduel, la mise en place de l’état d’urgence durant deux ans, à la suite des attentats du 13 novembre 2015, leur a grand ouvert les portes de la juridictionnalisation. En raison de la nature préventive des actes prévus par la loi de 1955 (Loi n° 55-385 du 3 avr. 1955 relative à l’état d’urgence, JO 7 avr.), le juge administratif s’est trouvé saisi de nombreuses mesures administratives restrictives de liberté (assignations à résidence, interdictions de séjour, dissolution d’associations, perquisitions administratives) reposant sur de telles notes. Le Conseil d’État a donc, très rapidement, élaboré de façon prétorienne une politique d’usage des notes blanches à titre probatoire en matière administrative, en soumettant leur caractère probant à trois conditions cumulatives : le contenu des notes doit être précis et circonstancié, les notes doivent avoir été versées au débat contradictoire, et, enfin, elles ne doivent pas faire l’objet d’une « contestation sérieuse » de la part du requérant (CE 11 déc. 2015, n° 394989, Dalloz actualité, 15 déc. 2015, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2015. 2404 ![]() ; RFDA 2016. 105, concl. X. Domino
; RFDA 2016. 105, concl. X. Domino ![]() ). Lorsque ces conditions sont réunies, la note blanche bénéficie d’une valeur probante (Circ. du 5 nov. 2016 relative à l’articulation des mesures administratives et des mesures judiciaires en matière de lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation, NOR : JUSD1633563C), si ce n’est d’une présomption de vérité particulièrement difficile à renverser (les juges administratifs se montrant rétifs à admettre l’existence d’une contestation sérieuse, v. par ex., TA Dijon, 21 nov. 2016, n° 1602449, J.-P. Foegle et N. Klausser, La zone grise des notes blanches, Délibérée, vol. 2, n° 2, 2017, p. 41 s.).
). Lorsque ces conditions sont réunies, la note blanche bénéficie d’une valeur probante (Circ. du 5 nov. 2016 relative à l’articulation des mesures administratives et des mesures judiciaires en matière de lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation, NOR : JUSD1633563C), si ce n’est d’une présomption de vérité particulièrement difficile à renverser (les juges administratifs se montrant rétifs à admettre l’existence d’une contestation sérieuse, v. par ex., TA Dijon, 21 nov. 2016, n° 1602449, J.-P. Foegle et N. Klausser, La zone grise des notes blanches, Délibérée, vol. 2, n° 2, 2017, p. 41 s.).
Ainsi, le recours juridictionnel aux notes blanches n’est pas inédit, et la Cour européenne des droits de l’homme elle-même en a, depuis longtemps, admis la possibilité, en appuyant toutefois sur la nécessité qu’elles soient préalablement soumises au contradictoire (CEDH, gr. ch., 19 févr. 2009, A et autres c/ Royaume-Uni, n° 3455/05, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ![]() ; RSC 2009. 672, obs. J.-P. Marguénaud
; RSC 2009. 672, obs. J.-P. Marguénaud ![]() ; pour une récente confirmation, CEDH 19 janv. 2023, Pagerie c/ France, n° 24203/16, Dalloz actualité, 30 janv. 2023, obs. E. Maupin ; AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss
; pour une récente confirmation, CEDH 19 janv. 2023, Pagerie c/ France, n° 24203/16, Dalloz actualité, 30 janv. 2023, obs. E. Maupin ; AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ![]() ; RSC 2009. 672, obs. J.-P. Marguénaud
; RSC 2009. 672, obs. J.-P. Marguénaud ![]() ). En revanche, le juge judiciaire ne s’était encore jamais prononcé en la matière. La décision du 5 décembre 2023 présente ainsi un caractère particulièrement original puisqu’elle vient, pour la première fois, expliciter le positionnement du juge judiciaire sur la question épineuse de l’usage probatoire des notes blanches. En revanche, précisons d’emblée que la mesure concernée reste une mesure administrative, et que la présente décision n’est donc pas applicable à d’éventuelles notes blanches qui seraient apportées au cours d’enquêtes pénales ou d’instructions judiciaires. Si le juge judiciaire se trouve saisi de la question en l’espèce, c’est parce que son autorisation est requise afin que le préfet puisse procéder à la visite domiciliaire préventive. C’est donc en conservant ce contexte préventif à l’esprit qu’il faut analyser la portée de la présente décision.
). En revanche, le juge judiciaire ne s’était encore jamais prononcé en la matière. La décision du 5 décembre 2023 présente ainsi un caractère particulièrement original puisqu’elle vient, pour la première fois, expliciter le positionnement du juge judiciaire sur la question épineuse de l’usage probatoire des notes blanches. En revanche, précisons d’emblée que la mesure concernée reste une mesure administrative, et que la présente décision n’est donc pas applicable à d’éventuelles notes blanches qui seraient apportées au cours d’enquêtes pénales ou d’instructions judiciaires. Si le juge judiciaire se trouve saisi de la question en l’espèce, c’est parce que son autorisation est requise afin que le préfet puisse procéder à la visite domiciliaire préventive. C’est donc en conservant ce contexte préventif à l’esprit qu’il faut analyser la portée de la présente décision.
Si le juge judiciaire semble, de prime abord, reprendre les conditions énumérées par le juge administratif afin d’admettre le recours aux notes blanches (caractère précis et circonstancié, soumission au contradictoire, absence de contestation sérieuse par le requérant), quelques spécificités apparaissent après une lecture plus approfondie de l’arrêt.
Soulignons, à titre liminaire, que – et cela tient au contexte factuel de la décision –, tandis que la grande majorité des décisions rendues en la matière par le Conseil d’État font référence à des notes blanches parmi d’autres éléments du dossier, ici la chambre criminelle se trouve confrontée à une note blanche qui constitue, à elle seule, le fondement exclusif de la mesure concernée (ce que contestait le pourvoi). Mais surtout, le point de divergence principal avec la jurisprudence administrative réside dans la condition tenant au versement de la note au débat contradictoire. En effet, l’autorisation du JLD, en matière de visite domiciliaire préventive, est rendue sans audience et sans débats, si bien que c’est seulement en cas de recours exercé devant le premier président de la Cour d’appel de Paris que l’intéressé pourra avoir connaissance de la note blanche et ainsi, la « contester sérieusement ». En effet, l’individu n’ayant pas formé de recours n’étant alors informé ni de l’existence, ni du contenu d’une note blanche, comment la condition liée à « l’absence de contestation sérieuse » (formule utilisée par les juridictions administratives), pourrait-elle être remplie ? Cette impasse explique le remaniement terminologique de la condition par la chambre criminelle, qui n’exige alors pas une « absence de contestation sérieuse », mais prévoit simplement qu’« en cas de contestation sérieuse », l’administration devra apporter des éléments complémentaires. La condition tenant à l’absence de contestation par l’intéressé semble ainsi ne pas être exigée par le juge judiciaire, puisqu’une décision contraire serait contrecarrée par l’absence de versement au débat contradictoire de la note blanche devant le JLD… La chambre criminelle n’avait donc guère d’autres choix que d’œuvrer par un « tour de passe-passe » afin de contourner cet obstacle.
Or, tant au regard d’éventuelles contestations de futures visites domiciliaires qu’au regard du pouvoir d’appréciation des actes administratifs que le juge pénal tient de l’article 111-5 du code pénal, il ne fait aucun doute que le juge judiciaire sera amené à apprécier la régularité de plus en plus de mesures administratives fondées sur des notes blanches. Aussi, afin de prévenir un recours et une condamnation éventuelle par la Cour européenne des droits de l’homme (qui exige le versement des notes blanches aux débats), il serait judicieux d’instaurer une procédure contradictoire préalablement à la décision d’autorisation du JLD, lequel est amené à prendre en considération l’ensemble des éléments contenus dans la requête afin de vérifier que les conditions de la visite domiciliaire soient bien réunies.
La précision des conditions de la visite domiciliaire préventive
Les visites domiciliaires prévues par l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure constituent le prolongement, en droit commun, des perquisitions administratives prévues en période d’état d’urgence (Loi du 3 avr. 1955, art. 11). En effet, de 2015 à 2017 (période d’état d’urgence), les autorités administratives ont pu avoir recours à un certain nombre de mesures administratives restrictives de liberté, afin de contenir et prévenir la menace terroriste qui s’est tristement cristallisée dans les attentats du 13 novembre 2015. Le législateur, soucieux de maintenir la prévention du terrorisme en dehors de toute période exceptionnelle, a introduit dans le droit commun, par la loi SILT (Loi n° 2017-1510 du 30 oct. 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, JO 31 oct.), plusieurs mesures administratives directement inspirées de celles prévues par la loi de 1955. Ces mesures, initialement temporaires, ont été pérennisées par la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (JO 31 juill.). C’est ainsi que les visites domiciliaires ont définitivement intégré le code de la sécurité intérieure afin de prendre le relai des perquisitions administratives. Le choix du terme « visite domiciliaire », en lieu et place de celui de « perquisition », en dépit de l’euphémisme qu’il peut induire, a le mérite de distinguer clairement cette mesure des perquisitions administratives (prévues en état d’urgence) et judiciaires (prévues en matière pénale, en cas d’ouverture d’une enquête ou d’une instruction).
En effet, tandis que la perquisition administrative poursuit un objectif de prévention des menaces générales pour la sécurité et l’ordre publics, la visite domiciliaire de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure est strictement limitée à la prévention du terrorisme. Par ailleurs, comparativement à la perquisition de la loi de 1955, qui revêt une nature entièrement administrative (compétence exclusive de l’autorité administrative), la nouvelle visite domiciliaire présente une nature hybride, qui la place précisément entre la mesure administrative (par son objectif préventif et la compétence du préfet) et la mesure judiciaire (par l’autorisation délivrée par le JLD et l’avis recueilli du procureur de la République antiterroriste). En effet, afin de pouvoir effectuer une telle visite, le préfet doit saisir le JLD (du Tribunal judiciaire de Paris, ce qui renforce la centralisation propre à la matière terroriste) afin que ce dernier l’y autorise. Pour ce qui est du fond de la mesure, c’est précisément l’objet de la présente décision, qui prend le soin – et le temps – d’en développer les enjeux et les conditions.
Ainsi, dans un premier temps, après avoir rappelé le contenu de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure prévoyant les visites domiciliaires, tel qu’analysé par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 29 mars 2018, n° 2017-695 DC, Dalloz actualité, 5 avr. 2018, obs. E. Maupin ; AJDA 2018. 710 ![]() ; D. 2018. 876, et les obs.
; D. 2018. 876, et les obs. ![]() , note Y. Mayaud
, note Y. Mayaud ![]() ; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ![]() ; Constitutions 2018. 277, chron. O. Le Bot
; Constitutions 2018. 277, chron. O. Le Bot ![]() ), la Cour de cassation valide leur conformité à la Convention européenne des droits de l’homme.
), la Cour de cassation valide leur conformité à la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle admet qu’une telle mesure présente une ingérence dans le droit à la vie privée et familiale, prévu par l’article 8 de la Convention, mais précise qu’une telle ingérence est justifiée par plusieurs objectifs légitimes dans une société démocratique (préservation de la sécurité nationale et de la sûreté publique, maintien de l’ordre public et prévention des infractions terroristes). Dans un deuxième temps, la chambre criminelle revient sur les trois principales conditions qui régissent les visites domiciliaires. La première condition tient au fait que l’autorité administrative doit démontrer : qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu concerné est fréquenté par une personne (premier élément), dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics (deuxième élément), menace qui doit être liée à la finalité préventive de la mesure, à savoir, un risque terroriste (troisième élément). La deuxième condition tient à l’extériorisation de cette menace d’une particulière gravité, puisque cette dernière doit être liée au fait que l’individu concerné, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou organisation impliquées dans le terrorisme, soit adhère à une idéologie terroriste. Cette deuxième condition doit, elle aussi, être démontrée par l’autorité administrative. Enfin, la troisième condition soulevée par la Cour tient au rôle du JLD, qui doit autoriser la mesure par une ordonnance écrite et motivée, mais également contrôler son exécution, en étant tenu informé de son déroulement, afin de pouvoir y mettre fin à tout moment.
Après avoir rappelé les conditions de fond de la visite domiciliaire, qui doivent être démontrées par l’administration, la chambre criminelle revient, dans un troisième temps, sur l’obligation qui incombe au JLD (et au premier président de la Cour d’appel de Paris en cas de recours). L’autorité judiciaire doit ainsi vérifier que la visite domiciliaire est nécessaire et proportionnée au regard des conditions de fond démontrées par l’administration. Le premier président de la Cour d’appel de Paris a déduit des divers éléments factuels énoncés dans la note blanche sur laquelle reposait la requête du préfet, que tant l’individu que l’association qu’il co-préside (et donc qu’il fréquente nécessairement), diffusent ou adhèrent à des thèses terroristes, et qu’ainsi le comportement de l’intéressé présentait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Le caractère actuel de la menace, qui était contesté par le pourvoi, est donc déduit du fait que l’intéressé est resté le dirigeant d’une association qui, elle-même, adhère à une idéologie terroriste. Autrement dit, le seul fait que l’intéressé préside une association adhérant à des thèses terroristes suffit, par ricochet, à présumer sa propre adhésion, actuelle, à de telles thèses. Ainsi, peu importe que les éléments rapportés afin de caractériser la menace qu’il représente remontent à plusieurs années, puisqu’en continuant à diriger une telle association, il démontre l’ancrage et la persistance de son adhésion à une idéologie terroriste.
© Lefebvre Dalloz